
Figure 1 – Production mondiale de fibres par type entre 1980-2030 – Source
Pour réduire l’utilisation des matières premières, il faut consommer moins et autrement. Beaucoup de personnes ont sans doute une image d’austérité à ce sujet. Cela pourrait expliquer pourquoi la politique d’économie circulaire note régulièrement qu’une plus grande attention devrait être accordée aux stratégies de circularité plus élevée, c’est-à-dire consommer moins et différemment, mais ne fournit par la suite que peu de détails à ce sujet.
Pourtant, il existe de nombreux exemples réussis montrant qu’il est déjà possible de consommer moins et différemment. Ce chiffre ne fera qu’augmenter dans un avenir proche, compte tenu des succès déjà obtenus. Cet article vise à montrer, à l’aide d’exemples de réussites existantes et d’initiatives en cours, combien une telle société peut encore être bénéfique. RNB trouve cela important car consommer moins et différemment, (“consuminderen” et “consumeranderen” en néerlandais), ne réussira que si les consommateurs et les producteurs sont prêts à l’accepter.
Malheureusement, le changement climatique, la perte de biodiversité et d’autres problèmes environnementaux mettent le temps à rude épreuve. C’est pourquoi nous appelons les politiciens et les députés à promouvoir activement une vision et à montrer par des exemples à quel point un tel avenir dans lequel nous consommons moins et différemment peut être beau. Il est essentiel d’inclure les Pays-Bas dans cette vision large de l’avenir afin de susciter un soutien à la politique actuelle et future (d’économie circulaire).
Le gouvernement néerlandais a soumis la stratégie nationale sur les matières premières à la Chambre des représentants en décembre 2022 et le programme national d’économie circulaire (NPCE) en février 2023. Le troisième document politique, le Programme national de politique environnementale (NMP), devrait être adopté fin 2023. Les trois documents politiques sont pertinents pour l’économie circulaire.
Le NMP portera sur la manière dont le gouvernement veut garantir un environnement de vie sain, propre et sûr d’ici 2050 et rendre les risques environnementaux négligeables. Le NMP le fera sur la base de trois tâches principales, parmi lesquels une économie durable et circulaire (voir figure ci-dessous). Le NPCE en est en fait une élaboration.
Via l’utilisation néerlandaise de matières premières, le NPCE veut faire face au défi climatique, au défi de la biodiversité, à la création d’un environnement propre et d’un cadre de vie sûr et propre, et contribuer à la sécurité d’approvisionnement en matières premières. La sécurité d’approvisionnement concerne la disponibilité des matières premières pour l’économie néerlandaise. La politique relative aux matières premières critiques est définie dans la Stratégie nationale sur les matières premières.
La figure ci-dessous montre la relation entre les trois documents politiques. Le NMP et le NPCE partagent comme tâches principales un environnement de vie sain et plus propre ainsi que des écosystèmes et une biodiversité vitaux. Le NMP examine toutes les causes et solutions pour ces tâches principales. Le NPCE se concentre sur l’utilisation des ressources comme cause et solution.
RNB a mené une analyse plus approfondie du NPCE (voir ici) et de la Stratégie nationale sur les matières premières (voir ici). Le NPCE fournit l’aperçu le plus complet de la politique d’économie circulaire du gouvernement pour les années à venir.
Le NPCE s’écarte sur un point important du programme politique gouvernemental Circulaire Pays-Bas en 2050 de 2016. Circulaire Pays-Bas en 2050 a toujours pour objectif principal de réduire l’utilisation de matières premières. Pour le NPCE, réduire l’utilisation des matières premières est tout au plus un moyen de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, de réduire la pression environnementale et de garantir l’approvisionnement en matières premières de l’économie néerlandaise.
Le NPCE affirme même dans son introduction que « notre économie du futur nécessite des matières premières plus nombreuses et différentes que notre économie jusqu’à présent ». Dans le même temps, le NPCE déclare en outre que l’utilisation néerlandaise de matières premières, tant au niveau national qu’à l’étranger (mais pour l’économie néerlandaise), doit être réduite. Le NPCE souhaite aujourd’hui réduire cette empreinte matières premières de 50 % d’ici 2030 et de 75 % d’ici 2050.
Le NPCE est donc un peu confus quant à cette empreinte matière première. Dans les pages précédant la mention de ces objectifs de réduction des matières premières de 50 % et 75 %, le NPCE déclare également qu’il souhaite réduire l’empreinte néerlandaise des matières premières (uniquement) de telle sorte que notre utilisation de matières premières reste dans les limites planétaires . Dans le NPCE, la réduction des ressources n’est donc pas un objectif en tant que tel, mais un moyen de rentrer dans les limites planétaires. Cela ne doit pas nécessairement correspondre à une réduction de 50 à 75 % de la consommation de matières premières. Le NPCE souhaite toujours étudier ce lien entre l’utilisation des matières premières, le changement climatique, la biodiversité et un environnement et un cadre de vie plus propres.
Le NPCE souligne que les conséquences environnementales de notre utilisation de matières premières ne doivent pas être répercutées sur d’autres pays. Cependant, il ne fait aucune mention du partage équitable de notre prospérité matérielle avec les pays qui sont loin derrière nous dans ce domaine. Cette dernière solution est peut-être inhérente à l’intention politique de garantir que l’empreinte des matières premières néerlandaises reste dans les limites planétaires. C’est très implicite.
RNB préconise que la réduction de l’utilisation des matières premières, tout comme aux Pays-Bas sera circulaire en 2050 , soit à nouveau explicitement incluse comme objectif principal (tâche principale) dans la politique d’économie circulaire. Ceci est conforme aux recommandations du Groupe d’experts internationaux sur les produits de base des Nations Unies. Dans son étude des ressources de 2019, il affirme que l’utilisation de matières premières dans les pays à revenu élevé doit et peut être réduite à un point tel que, à l’intérieur des frontières planétaires, les pays à faible revenu puissent partager à parts égales une prospérité toujours croissante.
Moins d’utilisation de matières premières nécessite une consommation moindre et différente. Pensez au covoiturage et à la réparation des vêtements au lieu d’en acheter de nouveaux. Quand on pense consommer moins et autrement, on pense vite à l’austérité. Certes, la recherche de consommer moins (“consuminderen”) et de consommer différemment (“consumanderen”) donne rapidement lieu à des astuces comme faire ses courses plus consciemment, ne rien acheter pendant un mois et faire un ménage en profondeur. Généralement dans le but d’avoir un aperçu du peu dont une personne a réellement besoin et de la quantité d’espace et d’argent qu’elle peut économiser.
En ces temps de forte inflation, économiser de l’argent est bien sûr un bonus. En même temps, nous préférons ne rien abandonner à notre guise, et la propriété est un signe de prospérité et de réussite. Cela crée un « paradoxe circulaire ». Marko Hekkert, directeur de l’Agence d’évaluation environnementale PBL, le souligne lors d’une récente conférence. Faire réparer des choses est souvent coûteux – si cela est même possible – et le dernier smartphone est plus souhaitable pour de nombreuses personnes qu’un ancien mais toujours fonctionnel.
Il n’est pas non plus facile pour les consommateurs de faire réparer leurs appareils ou produits cassés. Le neuf est souvent moins cher, les produits sont difficiles, voire impossibles à réparer, ou encore un réparateur est difficile à trouver. Heureusement, de nos jours, les gens peuvent apporter gratuitement leurs objets cassés, en particulier leurs appareils électroménagers, dans de nombreux cafés pour les réparer. Il existe également depuis peu un annuaire des réparateurs auprès d’entreprises reconnues pour la réparation d’appareils électroniques grand public (qui doit être complété par des entreprises de réparation). L’Europe réfléchit actuellement activement à la manière dont le droit à la réparation des consommateurs devrait être réglementé.
Il existe déjà de nombreuses innovations qui nous aident à consommer moins. Le smartphone en fait partie. En plus de passer des appels téléphoniques, vous pouvez également prendre des photos, écouter de la musique, rechercher des informations, envoyer des e-mails, etc. Avec un smartphone, vous n’avez plus besoin de tous ces appareils séparés. Cela nous a rendu la vie plus facile à bien des égards.
Le smartphone en remplacement du Walkman, de l’appareil photo, etc. n’est qu’une des nombreuses innovations qui ont rendu la vie plus amusante et plus facile. D’ailleurs, le fairphone va encore plus loin en termes de circularité, car, par exemple, l’appareil photo ou l’écran peuvent être remplacés et mis à niveau. Nous aimerions mentionner ici quelques autres innovations circulaires ou innovations ayant des bénéfices circulaires.
Toujours dans le domaine numérique, des services tels que Spotify et Netflix rendent superflues les CD contenant de la musique ou des images (~ 17 grammes de plastique) et leurs boîtes en plastique (~ 75 grammes). Parallèlement, les ventes de musique et d’images sur CD ont fortement chuté. Cela permet d’économiser beaucoup de plastique. La question de savoir si la consommation d’énergie de ces services de streaming entraîne ou non plus de changement climatique – comparé à la production de tout ce plastique et son traitement en fin de vie – fait débat.
Une innovation plus ancienne est l’agrafeuse sans agrafes , qui utilise une encoche astucieuse pour maintenir plusieurs pages ensemble sans agrafes. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’une agrafeuse « vide ». Cela permet également d’économiser des coûts pour les agrafes et d’éviter que le métal ne se retrouve dans les vieux papiers.
Les tablettes de lavage sont courantes depuis longtemps. Grâce à leur quantité dosée de lessive, les tablettes de lessive évitent une utilisation excessive de lessive en vrac par les consommateurs. Les produits peu emballés tels que les barres de shampoing, les lotions capillaires et les comprimés de dentifrice ne sont pas encore courants, mais sont déjà disponibles dans la plupart des pharmacies.
Récemment, les médias ont appris qu’une brasserie allemande lançait de la bière en poudre. Cela réduit le contenu d’une bouteille de bière de 90 % (en eau) et la bouteille de bière elle-même n’est plus nécessaire. Cela réduit considérablement les coûts financiers et environnementaux du transport.
Les boissons gazeuses sous forme de poudre ou de sirop permettent également d’économiser un volume considérable de transport d’eau et de bouteilles en plastique. Il est peu notoire que les consommateurs peuvent déjà utiliser une machine à eau gazeuse avec, entre autres, une bouteille pétillante de Sodastream et des sirops Pepsi. Le secteur de la restauration utilise depuis bien longtemps des systèmes de robinetterie ou des systèmes postmix (voir par exemple ici et là).
Des bibliothèques d’outils peuvent déjà être trouvées dans de nombreux endroits en Belgique (comme ici et là). Pourquoi voudriez-vous posséder une perceuse si vous ne l’utilisez que quelques fois par an ? Il en va de même pour un scarificateur qui n’est utilisé qu’une seule fois au printemps et en automne pour aérer la pelouse du jardin. Les personnes qui ne souhaitent effectuer que des travaux occasionnels ou qui n’ont pas de place pour de nombreux outils de jardinage peuvent emprunter les outils dont ils ont besoin dans la bibliothèque d’outils pour une petite somme. Il existe désormais également une bibliothèque d’outils de ce type à La Haye et, espérons-le, d’autres suivront bientôt aux Pays-Bas.
En plus des bibliothèques d’outils, la Belgique dispose également de bibliothèques pour bébés avec du matériel pour bébé, de Wielekes pour “faire grandir” les vélos des enfants, de ludothèques avec des jeux, de kayaks et de bateaux partagés, etc. Les Pays-Bas peuvent prendre exemple sur leurs voisins du sud. Par ailleurs, les ludothèques existent depuis longtemps aux Pays-Bas.
Le covoiturage est peut-être l’exemple le plus connu de la tendance du partage. Dans les centres-villes très fréquentés, les gens choisissent de plus en plus de ne pas avoir leur propre voiture, mais optent pour le covoiturage via des plateformes de partage ou des services tels que « Wheels for all » ou Cambio. Cela signifie que moins de voitures sont nécessaires et qu’elles ne passent plus 90 % ou plus de leur temps inutilisées sur le bord de la route.
Moins connue est une autre plateforme de partage telle que Peerby. Ici, tout peut être emprunté et partagé. Une fonction de recherche permet de trouver ce dont vous avez besoin dans votre propre région et de conclure ensuite des accords sur son utilisation.
De nombreuses villes disposent de magasins zéro déchets où les consommateurs remplissent leurs propres emballages de produits séchés tels que du riz, des pâtes, des céréales, des haricots, des lentilles, des morceaux de soja, des herbes, etc. On trouve également des détergents liquides et des détergents à vaisselle. Les produits liquides comestibles, comme les produits laitiers, sont conditionnés en bouteilles qui sont re remplies via un système de consigne. De nombreux produits alimentaires peuvent également être commandés en ligne sans ou avec peu d’emballage.
Divers endroits disposent de boutiques de cadeaux où les gens peuvent récupérer ou livrer des articles gratuitement. Ils constituent un bon complémentaire aux friperies, qui sont généralement bon marché, mais où il faut tout de même payer. De plus en plus de gens placent également de boîtes à cadeaux ou d’échange devant leur porte.
En matière de produits alimentaires, manger différemment et surtout moins peut être moins évident. Après tout, une personne doit manger. Pourtant, il existe également d’innombrables façons de faire la différence.
La manière la plus simple est de manger des fruits et légumes de saison. Ceux-ci sont généralement cultivés aux Pays-Bas, sans nécessiter beaucoup de chauffage dans les serres (nécessaire hors saison). De ce fait, ils sont souvent moins chers et surtout plus savoureux que les fruits et légumes venus de loin et/ou hors saison.
Chaque année, environ 34 kilos de nourriture et 45 litres de boissons sont jetés par personne. La lutte contre le gaspillage alimentaire est donc particulièrement importante. Bien sûr, vous ne devriez tout simplement pas acheter (beaucoup) plus de nourriture que vous n’en mangez. Cependant, il existe également des parties de fruits et légumes qu’il est peu courant de manger (feuilles de carotte ou de fenouil, écorces d’orange), ou que certaines personnes n’aiment pas (écorces de pomme). Ceux-ci sont généralement encore jetés comme déchets, mais il existe de nombreux sites sur Internet proposant des recettes pour les utiliser.
Il existe de nombreuses initiatives intéressantes pour prévenir le gaspillage alimentaire plus tôt dans la chaîne. Via l’application Too Good To Go, les consommateurs peuvent acheter à bas prix des aliments et des boissons invendus dans leur quartier. Grâce à des activités de sensibilisation, Kromkommer s’efforce de garantir que les 10 % de fruits et légumes présentant des irrégularités externes soient consommés (ils sont encore souvent considérés comme invendables à l’heure actuelle). Instock cuisine dans deux restaurants avec des aliments qui n’atteignaient auparavant que le centre de distribution d’une grande chaîne de supermarchés et dispose d’un joli livre de recettes présentant de nombreuses techniques de conservation pour tout ce qui est comestible. De Verspillingsfabriek fabrique des soupes et des sauces à partir de légumes frais laissés par les producteurs, les coupeurs et les grossistes. Ces initiatives et bien d’autres ont rejoint la fondation Ensemble contre le gaspillage alimentaire. Ici, entreprises et organismes publics travaillent ensemble pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030.
Les exemples ci-dessus ne sont qu’une petite sélection des moyens existants pour réduire notre utilisation des ressources en consommant moins et en consommant autrement, sans compromettre notre niveau de vie. Certaines innovations, comme les smartphones et les tablettes de lessive, sont monnaie courante depuis longtemps. Pour d’autres, comme partager des produits avec d’autres utilisateurs, cuisiner avec des fanes de carottes ou se passer des fraises en hiver, nous devrons peut-être encore surmonter certains obstacles. Nous devons également nous demander si les nouveautés sont toujours meilleures ou plus modernes que les anciennes. Parce que la réparation est souvent encore difficile, les gens découvrent quelque chose de nouveau plus rapidement et plus facilement.
Les exemples circulaires ci-dessus s’appuient parfois sur des innovations technologiques, mais la plupart d’entre eux nécessitent principalement une innovation sociale ou un changement dans la façon dont nous sommes habitués à utiliser et à faire les choses, dont nous pensons aux choses existantes et aux alternatives, en adaptant notre idée de la prospérité et du luxe (acheter beaucoup de nouvelles choses). Partager des choses ou les utiliser plus longtemps nécessite également que nous ayons un rapport différent à la possession.
L’innovation sociale pourrait également contribuer à développer des solutions, par exemple, à la grave pénurie actuelle de logements : Selon l’Office européen des statistiques, Eurostat, les Néerlandais sont les plus susceptibles d’avoir une maison avec jardin après l’Irlande et le plus grand nombre de pièces par personne après Malte, et les Pays-Bas ont le pourcentage le plus élevé de personnes vivant dans une maison plus grande que ce dont ils ont besoin. De Correspondent (2021) a approfondi les données néerlandaises et a constaté que, depuis 1900, le prix au m2 a moins augmenté que les salaires (devenant donc plus abordable) et que le nombre de m2 par personne a triplé. Les personnes riches peuvent vivre plus longtemps et ainsi faire monter les prix de l’immobilier, en particulier dans les villes où les prix sont de toute façon plus élevés. Plus généralement, les personnes âgées, en particulier, vivent dans des maisons trop grandes. Ils ont acheté leur maison à une époque favorable et leurs enfants ont déménagé. Déménager leur est désormais difficile en raison du manque de maisons suffisamment petites, mais de nombreux logements supplémentaires sont possibles en divisant les maisons (0,5 million) et en passant à de nouvelles constructions sur des « emplacements vides » dans le même quartier (0,1 million). De Correspondent (2021) a également constaté que, par personne, les Néerlandais vivent dans des zones plus vastes que, par exemple, les Allemands et les Britanniques.
Le mantra actuel pour expliquer la pénurie de logements est « construire, construire, construire » (plus de nouvelles briques). L’article de De Correspondent (2021) soulève la question de savoir si le débat ne devrait pas également porter sur comment et dans quelle mesure nous voulons vivre, et sur la manière de mieux répartir l’espace de vie déjà disponible (moins de nouvelles briques). Ces types de discussions fondamentales ont désormais rarement lieu. Il ne s’agit pas de logement ni d’autres questions difficiles dans lesquelles notre façon actuelle de consommer et de vivre joue un rôle.
Revenons au NPCE et à la Stratégie Nationale des Matières Premières : Beaucoup de gens comprennent que notre façon actuelle de consommer entraîne des problèmes environnementaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la soupe de plastique dans les océans. Autrement, beaucoup de gens comprennent que notre façon de consommer a créé une dépendance géopolitique à l’égard de pays comme la Russie et la Chine. La guerre en Ukraine et la pandémie du coronavirus, entre autres, ont mis ce sujet au premier plan. Il y a également suffisamment de personnes qui comprennent l’importance de consommer moins pour que leurs enfants et/ou les pays les moins prospères puissent partager notre prospérité. Beaucoup moins de gens ont une idée de ce à quoi pourrait ressembler un avenir de consommation moindre (matérielle) et différente, à quel point cela peut être bénéfique, mais cela nécessite de regarder et de faire les choses différemment.
Les exemples ci-dessus montrent que les changements vers une consommation moins et différente sont souvent déjà en cours inaperçus. Mais tout peut aller plus loin et, dans certains domaines de la consommation, des solutions plus fondamentales peuvent être envisagées. C’est au tour du cabinet et des députés de montrer aux Pays-Bas, avec une vision et des exemples, à quel point un tel avenir peut être beau.
Rédigé par Chloé Schwizgebel, Recycling Network Benelux et Nina Maat, Bond Beter Leefmilieu
L’ambition d’une Flandre sans déchets sauvages grâce à un système de consigne ambitieux a-t-elle vraiment été fixée, ou 2023 sera-t-elle une année perdue ?
Malgré cette décision, il est trop tôt pour crier victoire. En effet, le choix de la ministre Demir d’opter pour la consigne ne porte pas forcément pour le système existant et connu, dans lequel les consommateurs rapportent leurs bouteilles vides dans les magasins et récupèrent immédiatement leur argent. Cela bien que ce système fonctionne déjà dans d’autres pays européens. D’ailleurs, une enquête réalisée par Test-Achats en 2021 a montré que plus de 88 % de la population belge accepte de rapporter les emballages aux points de collecte tels que les supermarchés.
La décision prévoit simplement que toutes les boîtes de conserve et les bouteilles en plastique seront consignées d’ici 2025 et que l’industrie disposera d’une année pour tester un nouveau système. Ce nouveau système demandera aux consommateurs de scanner un code QR sur l’emballage et le sac bleu avant de jeter leurs déchets.
Ne nous y méprenons pas : nous soutenons l’innovation. Mais rendre quelque chose qui existe “numérique” n’est pas forcément synonyme d’innovation. L’étude préliminaire commandée par Fost Plus a déjà mis en avant de nombreuses questions concernant la vie privée, la fraude et l’accessibilité du système de consigne numérique. En effet, tous les citoyens n’ont pas accès aux applications numériques ou même à un compte en banque. Ensuite, il s’agit de savoir qui supportera les coûts et les contraintes supplémentaires. Avec une consigne numérique, les coûts supplémentaires liés à l’impression des QR-codes sur les canettes pourraient par exemple être répercutés sur les consommateurs. En outre, il n’est pas certain que tous les producteurs puissent se mettre à niveau du nouveau système à temps, compte tenu notamment des nombreuses questions de faisabilité. Enfin, la question clé est la suivante : ce système réduira-t-il les déchets sauvages ? Il semble par exemple que les citoyens pourraient toujours laisser leurs emballages dans les déchets sauvages après les avoir scannés. Enfin, on ne sait pas si ce système contribuera à une économie réellement plus circulaire pour les emballages, en améliorant vraiment la collecte sélective ou en facilitant la mise en place d’un système pour les emballages réutilisables.
Ces faiblesses du système numérique ont d’ailleurs convaincu le Pays de Galles d’opter pour un système de consigne classique après des tests pilotes similaires sur cette consigne numérique.
Alors que le système de consigne classique a déjà fait ses preuves, le système numérique n’a plus que six mois pour faire ses preuves en Belgique. Son succès ou son échec dépendra de quelques éléments déterminants. Tout d’abord, pour qu’un système de consigne soit efficace, il doit réduire les déchets sauvages, et donc les coûts associés pour les citoyens et l’environnement. Deuxièmement, il doit être accessible à tous, indépendamment de l’âge, de la santé, de la mobilité ou de la capacité financière, avec ou sans internet, smartphone ou compte en banque. Troisièmement, il ne doit pas être 100% fiable en ce qui concerne la fraude et le respect des données privées.
La phase de pilotes de cette consigne numérique en Flandre ressemble davantage à une ultime tentative du secteur de l’emballage de se soustraire à ses responsabilités et donc à une perte de temps qui aurait pu être mieux investie dans la réduction des déchets sauvages. Une véritable innovation, par exemple, miserait sur l’éco-conception et la circularité des produits, en pensant déjà au réemploi en amont de la chaîne de production.
La ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, adopte donc une approche différente de celle de la Flandre. Elle aussi souhaite mettre en place la consigne en 2025 et a donc elle-même commandité une étude préparatoire sur la meilleure option. À cette fin, l’étude se fait de manière concertée avec les autres régions et les pays voisins, afin de garantir l’uniformité et l’accessibilité du système pour les citoyens.
Tout au long de ces projets pilotes, nous continuerons donc à insister sur la transparence, sur une planification claire avec des échéances précises et sur l’implication des différentes parties prenantes. De cette manière, nous atteindrons l’objectif premier de la consigne : moins de déchets sauvages dans notre environnement grâce à un système de consigne efficace et accessible en 2025.
Le Programme national pour l’économie circulaire (NPCE), qui vient d’être publié, comporte de nombreux points positifs. Par exemple, les voies consultatives pour les groupes de produits prioritaires fournissent des indications précieuses (chapitre 3), les mesures de soutien pour ces groupes de produits et d’autres sont essentielles (chapitre 4), et la bonne gouvernance des politiques d’économie circulaire est une priorité (chapitre 5). La tarification des dommages causés à l’environnement par les produits, ainsi que les exigences en matière de réparabilité et de conception sont également des mesures intéressantes.
Peut-être devrions-nous entrer dans les détails de toutes les bonnes choses contenues dans le NPCE. Toutefois, nous souhaitons attirer l’attention sur les raisons pour lesquelles ce nouveau plan de politique circulaire inquiète encore Recycling Netwerk Benelux (RNB). En effet, par rapport au précédent programme politique gouvernemental Nederland Circulair in 2050 de 2016, l’ambition du NPCE pour la politique d’économie circulaire a changé. De facto, la nouvelle ambition est un pas en arrière (considérable). Cela nécessite bien sûr une introduction et une explication.
L’avant-propos de la secrétaire d’État Vivianne Heijnen contient une phrase révélatrice : “Les Pays-Bas veulent être totalement circulaires d’ici 2050, avec le moins de déchets possible et sans gaspillage inutile de matières premières”. Qu’entendez-vous par “sans gaspillage inutile de matières premières” ? Dans Nederland Circulair pour 2050 parlait encore d’une réduction substantielle de l’utilisation des métaux primaires, des minéraux et des matières premières fossiles, à savoir une réduction de moitié d’ici 2030 et une circularité totale d’ici 2050.
Le secrétaire d’État mentionne les déchets avant les matières premières. Cela ne veut évidemment rien dire, mais donne l’impression que moins de déchets est plus important que moins de matières premières. De plus, il n’y a pas d’explication sur ce qu’on entend par “sans gaspiller inutilement les matières premières”. S’il est pris au pied de la lettre, il s’agit en fait aussi de déchets. En effet, les déchets sont des matières premières extraites mais qui ne sont pas (plus) utilisées. Il s’agit d’un gaspillage qui doit être évité. Cela n’a pas grand-chose à voir avec une moindre utilisation des matières premières en tant que telles. Le langage ambigu utilisé par la secrétaire d’État soulève à tout le moins des questions sur ce à quoi elle se réfère exactement.
Le résumé du NPCE indique ensuite que le passage à l’économie circulaire consiste à “…. de contribuer, par l’utilisation des matières premières, au défi climatique, au défi de la biodiversité, à la création d’un environnement propre et d’un cadre de vie sûr et propre, et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières. Dans une économie circulaire, presque seules les ressources primaires, secondaires et durables réutilisables sont en circulation. Les produits sont fabriqués, distribués et consommés dans des cycles fermés. Ainsi, la valeur des matières premières, des matériaux et des produits est préservée le plus longtemps possible, ce qui se traduit par une absence quasi-totale de déchets.”
Cette citation montre qu’il est important de modifier notre utilisation des ressources pour réduire la pression sur l’environnement et garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières premières. Elle indique également que la fermeture des cycles de production est un moyen efficace d’y parvenir et d’éviter les déchets. Comme si la circulation infinie de matériaux secondaires (en quantité illimitée) était l’essence même de l’économie circulaire. Une fois de plus, cela ne tient absolument pas compte de la nécessité d’utiliser beaucoup moins de matières premières.
La page 18 du NPCE explique pourquoi les précédents objectifs de réduction de l’utilisation des ressources néerlandaises ont été abandonnés. En fin de compte, il s’agit de contribuer au défi climatique, au défi de la biodiversité, à la création d’un environnement propre et d’un cadre de vie sûr et propre, et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières grâce à notre utilisation des matières premières.
Pour être clair, RNB travaille depuis des années pour répondre à la liste croissante des questions environnementales urgentes (en partie) par le biais de notre utilisation des matières premières. Il s’agit non seulement du climat, de la biodiversité et des déchets, mais aussi de l’azote, des déchets sauvages et de la soupe de plastique, entre autres. C’est pourquoi RNB s’est fortement engagé, par exemple, à réduire les emballages inutiles (comme ceux des fruits et légumes), à stimuler les emballages réutilisables (comme dans le secteur du e-commerce, par le biais du partenariat Mission Reuse), et à introduire largement la consigne comme condition préalable pour faire décoller correctement le recyclage aujourd’hui et, à terme, la réutilisation.
RNB soutient donc pleinement l’ambition du NPCE d’aborder les questions environnementales par le biais de l’utilisation des ressources. Il est logique que la sécurité de l’approvisionnement joue également un rôle.
Cependant, ce qui inquiète RNB, c’est que l’utilisation de moins de matières premières en tant que telles n’est plus un objectif de la NPCE, ni un élément de l’analyse des problèmes. C’était encore le cas du Nederland Circulair in 2050. L’augmentation de l’utilisation des ressources est un autre “[De plus, cette] évolution […] qui peut […] conduire à une inégalité croissante dans l’accès aux matières premières, les groupes de population les plus pauvres en souffrant le plus. Cela a une incidence sur la réalisation (ou non) des objectifs de développement durable (ODD)”.
Plus précisément, le NPCE affirme que “[En bref,] notre économie du futur nécessitera des matières premières plus nombreuses et différentes de celles de notre économie actuelle. Pour certaines matières premières, y compris les matières premières critiques, les stratégies circulaires ne peuvent pas répondre à l’augmentation de la demande à court terme et devront en mettre davantage en circulation.”
Nederland Circulair in 2050 vise à réduire de moitié notre utilisation de métaux primaires, de minéraux et de matières premières fossiles d’ici à 2030 et à devenir totalement circulaire d’ici à 2050. Le NPCE suppose une augmentation de notre utilisation future de matières premières. Le résumé du NPCE explique l’expression “entièrement circulaire” d’ici 2050 par le fait que “les impacts environnementaux de l’utilisation des ressources dans une économie circulaire, c’est-à-dire de l’ensemble de la production et de la consommation néerlandaises, se situent alors dans des limites “planétaires””. Une économie circulaire avec plus de matières premières mais dans les limites de la planète ne nous semble pas compatible.
Le mois dernier, s’adressant aux partis de gauche et de coalition à la Chambre basse, le professeur Jason Hickel, du mouvement Degrowth, a dénoncé le réalisme de l’augmentation de la production dans les limites de la planète. C’était après la publication du NPCE. Les recommandations déjà anciennes du Panel international des ressources des Nations unies vont dans le même sens.
Dans son identification des matières premières de 2019, le Groupe international des matières premières des Nations unies examine les tendances de l’utilisation des produits de base à l’échelle mondiale. Il montre que l’extraction des ressources mondiales a plus que triplé depuis 1970, les pays à revenu(s) élevé(s) en particulier récoltant les bénéfices au détriment des pays à revenu(s) faible(s). Selon le groupe d’experts, l’utilisation des ressources dans les pays à revenu élevé doit et peut être réduite de manière à ce que les pays à faible revenu puissent bénéficier proportionnellement d’une prospérité toujours croissante, mais dans les limites de la planète.
Contrairement au NPCE, mais conformément à Nederland Circulair in 2050, l’International Commodity Panel plaide donc pour une réduction de l’utilisation des matières premières dans les pays riches comme les Pays-Bas. Le PBL, dans son Integral Circular Economy Report 2023 (ICER-2023), parle lui aussi d’utiliser “des matières premières radicalement moins nombreuses et plus efficaces”. Même le Conseil économique et social (SER), dans son avis récent, parle d’utiliser moins de matières premières. RNB ne comprend donc pas pourquoi le NPCE part maintenant du principe que l’augmentation de l’utilisation des ressources aux Pays-Bas est nécessaire et souhaitable. Le RNB ne comprend pas non plus pourquoi, malgré une utilisation accrue des ressources, le NPCE pense pouvoir respecter les limites planétaires.
Les objectifs de réduction pour 2030 et 2050 dans Nederland Circulair in 2050 concernent la diminution de l’utilisation primaire des métaux, des minéraux et des matières premières fossiles, appelées en abrégé matières premières abiotiques. Il s’agit à la fois des matières premières et des matériaux (primaires) nouvellement fabriqués à partir de ces dernières.
Nederland Circulair in 2050 vise à réduire l’utilisation des matières premières abiotiques par le biais de trois objectifs stratégiques. Deux d’entre eux concernent l’utilisation plus efficace des matières premières dans les chaînes de produits existantes (1er objectif) et nouvelles (3e objectif). L’autre objectif (2e) vise à remplacer les matières premières fossiles, critiques et produites de manière non durable par des matières premières produites de manière durable, renouvelables et largement disponibles.
Pour ce deuxième objectif stratégique, l’objectif de substitution, le remplacement par des matières premières d’origine biologique (c’est-à-dire des matières premières biotiques, des matières premières biosourcées ou de la biomasse) est souvent considéré comme une interprétation. Cependant, le programme de transition pour la biomasse et l’alimentation de 2018 souligne que la biomasse n’est pas non plus disponible indéfiniment (en tout cas pas de la manière dont elle est produite actuellement). L’augmentation de la population mondiale et des niveaux de prospérité accroît la demande alimentaire, et la transition énergétique entraîne déjà une demande substantielle de biomasse. La disponibilité des terres pour la production d’aliments et de biomasse est également limitée, car l’espace est également nécessaire pour les loisirs et la conservation et la restauration de la biodiversité. La capacité de charge écologique de la Terre est déjà dépassée en raison de la nature et de l’ampleur de l’agriculture actuelle. Le programme de transition “Biomasse et alimentation” est clair à ce sujet.
En bref, il y a toujours quelque chose à dire contre l’idée d’une utilisation accrue des ressources et contre l’ambition de rester dans les limites de la planète. Le NPCE semble prendre ses désirs pour des réalités.
Nederland circulair in 2050 a toujours pour principal objectif la réduction des matières premières. Le NPCE le remplace par un cadre pour quatre nouveaux objectifs clés à développer davantage. Ces quatre objectifs principaux, appelés objectifs d’impact, concernent 1) la lutte contre le changement climatique, 2) la restauration de la biodiversité, 3) un environnement et un cadre de vie plus propres, et 4) une sécurité accrue de l’approvisionnement en matières premières.
D’ici 2050, le NPCE souhaite “qu’au moins l’utilisation des ressources pour la production et la consommation néerlandaises soit réduite au point de se situer dans les limites planétaires et que l'”espace opérationnel sûr” qui en résulte pour les Pays-Bas (…)”. Cela semble conforme à ce que le Panel international des ressources dit à ce sujet dans son identification des matières premières de 2019 (voir ci-dessus). Cet espace opérationnel sûr pour les Pays-Bas doit alors permettre une répartition égale des richesses au niveau mondial. Le NPCE ne dit rien d’autre à ce sujet.
Le NPCE souhaite étudier le lien entre l’utilisation des ressources et leur impact sur l’environnement. Cela devrait permettre de mieux comprendre le lien entre les objectifs d’impact et l’espace opérationnel sûr. Sur cette base, le NPCE souhaite fixer un nouvel objectif ambitieux de réduction de l’utilisation des ressources d’ici à 2030, avec une perspective jusqu’en 2050. Le NPCE n’explique pas comment cet objectif de réduction ambitieux est lié au postulat susmentionné du NPCE selon lequel notre économie de demain sera composée d’un plus grand nombre de matières premières différentes. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure l’objectif ambitieux de réduction des matières premières est en contradiction avec ce postulat.
Cet objectif de réduction ambitieux se rapportera à l’utilisation totale des matières premières néerlandaises tout au long de la chaîne internationale. Ce que l’on appelle l’empreinte des matières premières reflète l’utilisation totale des matières premières primaires aux Pays-Bas et ailleurs pour l’économie néerlandaise.
La recherche pour l’élaboration concrète des quatre objectifs d’impact sera commandée par le NPCE en 2023, dans le but d’être en mesure de prendre une décision en 2024. “D’ici là, l’objectif directeur de réduction de moitié des matières premières abiotiques d’ici 2030 reste en vigueur”, précise le NPCE.
Un peu plus loin dans le NPCE, à propos des objectifs de réduction à fixer, on trouve la phrase peu claire suivante : “Nous examinons dans quelle mesure nous pouvons nous aligner sur les taux de réduction proposés pour l’empreinte des matières premières dans le cadre de la taxonomie de l’UE, à savoir 50 % d’ici 2030 et 75 % d’ici 2050.” Cette formulation peu engageante suggère, mais ne réaffirme pas encore, le maintien de l’objectif de réduction de moitié d’ici 2030 et la concrétisation de l’objectif “tout circulaire” d’ici 2050 dans Nederland Circulair in 2050. En outre, il n’est pas clair de savoir comment cela se concilie avec l’hypothèse du NPCE selon laquelle notre économie de demain sera composée d’un plus grand nombre de matières premières et de matières premières différentes.
La réduction de l’utilisation des ressources est l’un des quatre leviers à actionner dans le NPCE pour atteindre ses quatre objectifs d’impact. Selon le NPCE, qui s’appuie sur une note d’orientation du PBL de 2021, les quatre boutons représentent une “simplification” de l’échelle R :
La substitution des matières premières, qui correspond au deuxième objectif stratégique de Nederland circulair in 2050, ne fait toutefois pas partie de l’échelle de circularité. L’échelle de circularité vise à réduire l’utilisation de matières premières dans les chaînes de produits existantes et nouvelles.
Dans le cadre de l’élaboration des 1er et 3e objectifs stratégiques de Nederland circulair in 2050, le projet de système de suivi des progrès vers l’économie circulaire a attribué un rôle important à l’échelle de circularité. Ce faisant, l’avertissement du programme de transition Biomasse et Alimentation a été pris à cœur. Le projet de système de suivi, qui sert de base aux RCED de 2021 et 2023, part du principe que l’utilisation de toutes les matières premières doit être réduite, y compris la biomasse (ou les matières premières biotiques primaires).
La substitution reste donc une stratégie de circularité, mais elle vise à utiliser des matières premières différentes, mais pas moins. L’objectif de substitution n’est donc pas d’un ordre inférieur mais différent de l’objectif de l’échelle de circularité consistant à utiliser moins de matières premières. En fait, le NPCE lui-même le dit dans une note de bas de page de la figure 4 (“La substitution ne fait pas partie de l’échelle R”).
Une étude récente de Potting et al (2022) montre que “ralentir et fermer la boucle” peut également entraîner des réductions significatives de l’utilisation des ressources. Les troisième et quatrième levier du NPCE visent à faire autant que le premier bouton “réduire la boucle”. Cela rend la description du premier bouton “maladroite”. Il serait préférable de décrire “réduire la boucle” comme étant simplement “utiliser moins de produits en s’en débarrassant, en les partageant ou en les rendant plus efficaces” (éliminant ainsi la première partie “Réduire l’utilisation des ressources : utiliser moins de ressources (primaires)”).
Avec cet ajustement mineur, les trois boutons réunis représentent une belle simplification de l’échelle de circularité. Le NPCE l’illustre dans la figure 4.
Le projet de système de suivi de 2018 a évalué les intentions politiques de l’époque sur la mesure dans laquelle les stratégies de circularité étaient prises en compte. Il a conclu que la plupart des intentions politiques de l’époque étaient encore axées sur le recyclage. Malheureusement, peu d’intentions politiques à l’époque abordaient les stratégies plus élevées dans l’échelle de circularité.
La même évaluation des intentions politiques que dans le projet de système de suivi n’a pas été répétée dans l’ICER-2023. C’est regrettable. Il aurait également été intéressant de disposer d’une telle évaluation pour les voies de conseil des équipes de transition circulaire qui sont examinées en détail au chapitre 3 du NPCE.
L’ICER-2023 note, sur la base de recherches PBL antérieures, que relativement peu d’entreprises mettent encore en œuvre des stratégies de circularité plus élevée. Le NPCE souhaite donc que ces stratégies fassent l’objet d’une plus grande attention. Cette observation vient après le chapitre 3 sur les voies de conseil tels qu’ils ont été élaborés par les équipes de transition concernées.
La section 2.1 du NPCE aborde déjà la manière dont les quatre boutons de substitution et de boucle étroite, lente et fermée doivent être traduits en mesures. En fait, quatre pages sont consacrées à la substitution, deux pages à la réduction de la boucle et trois pages au ralentissement de la boucle. Onze pages sont consacrées à la fermeture de la boucle, c’est-à-dire au traitement des déchets de haute qualité. Cinq d’entre elles traitent du recyclage et les autres de la collecte (séparée) des déchets, de l’incinération et de la mise en décharge. L’accent est donc mis sur le traitement des déchets.
Les deux pages consacrées à la réduction de la boucle indiquent, entre autres, que le gouvernement central ne s’oriente pas directement vers une réduction de la production et de la consommation, car les citoyens doivent pouvoir choisir librement. Le NPCE mentionne l’interdiction récente d’un certain nombre de produits en plastique jetables et signale une orientation indirecte, notamment par le biais de la fiscalité et de la sensibilisation. Cependant, rien de tout cela n’est encore très concret. L’exemple concret de la taxation des produits du tabac n’a pas grand-chose à voir avec l’économie circulaire, mais plutôt avec la santé publique.
Le projet de règlement sur les emballages de la Commission européenne, qui remplacera la directive actuelle sur les emballages, s’engage fortement en faveur de la réutilisation des emballages. Cela ne manquera pas d’avoir un impact sur la politique néerlandaise en matière d’emballages. Le chapitre 3 du NPCE traite en détail des ambitions et des mesures pour les chaînes de produits prioritaires, ainsi que d’une sélection de groupes de produits spécifiques couverts par ces chaînes.
En ce qui concerne la gouvernance, au chapitre 5, le NPCE note à juste titre que les groupes de produits se trouvent à différents stades de la transition circulaire et qu’ils nécessitent donc des approches et une flexibilité différentes. En fait, de nombreuses petites transitions doivent être menées de front.
Le NPCE a également raison d’affirmer qu’il est nécessaire de convenir d’un certain nombre de composants de manière uniforme sur les grandes lignes, et d’expliciter qui en est responsable. En ce qui concerne RNB, une chose n’est pas dite.
La réduction de l’empreinte des Pays-Bas sur les matières premières nécessite un changement dans notre relation à consommer moins et différemment. Ce changement est nécessaire au niveau des groupes de produits, mais il serait utile que ce changement soit également communiqué par le gouvernement et la politique à un niveau global.
Outre les entreprises néerlandaises, les citoyens néerlandais doivent également être sensibilisés au fait que les choses doivent et peuvent être faites moins et différemment, et que cela ne signifie pas nécessairement un niveau de prospérité moindre. De nombreuses personnes le comprennent et divers médias y prêtent de plus en plus attention, comme récemment le NRC et CNVconnective. CBS a constaté que, en grande partie sous la pression des prix du gaz, la consommation de gaz aux Pays-Bas n’a jamais été aussi basse depuis 50 ans (la contribution de la pauvreté énergétique à ce phénomène n’est pas très réjouissante, bien sûr).
La société semble au-delà de “La Haye”. La politique et le gouvernement sont plutôt discrets sur le fait de consommer moins et différemment. Même le NPCE ne plaide pas vraiment en faveur de ce débat social et de cette innovation sociale nécessaires. Si nous voulons vraiment mettre en place la transition circulaire aux Pays-Bas, il est très utile que la grande majorité des gens soient d’accord avec le changement nécessaire dans la façon de penser et de faire.
Nous avons également publié une analyse de la stratégie néerlandaise sur les matières premières. Elle est disponible ici.
À partir du 1er avril 2023, la consigne sur les canettes sera en place. “Ce samedi, nous ferons à nouveau la fête, car il s’agit de la deuxième grande victoire dans ce dossier de longue haleine, après l’introduction de la consigne sur les petites bouteilles en plastique le 1er juillet 2021”, a déclaré Suze Govers, de Recycling Netwerk Benelux. “Mais, tout en étant heureux et fiers de ce résultat, nous trouvons regrettable que les consommateurs ne puissent plus récupérer leur consigne partout, et le montant de 15 centimes d’euro est également trop faible pour que le plus grand nombre possible de canettes soient rapportées.”
Comme pour les bouteilles, les canettes feront l’objet d’une consigne de 15 centimes d’euro. Les consommateurs récupéreront ce montant lorsqu’ils rapporteront leur canette, par exemple au supermarché. Les Pays-Bas disposaient déjà d’une consigne sur les grandes bouteilles en PET (consigne de 25 centimes d’euro) et, depuis l’été 2021, une consigne est également en place sur les petites bouteilles en PET. Cette mesure a immédiatement entraîné une diminution significative de la part de ces bouteilles parmi les déchets sauvages.
En revanche, la part des canettes dans les déchets sauvages n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Nous pensons qu’après l’introduction d’une consigne sur les canettes, nous assisterons aussi bientôt à une forte diminution, tout comme pour les bouteilles en plastique.
L’introduction d’une consigne sur les canettes n’est pas suffisante à elle seule. Le système doit de plus être mis en place correctement en tenant compte du consommateur afin de garantir que le plus grand nombre possible de canettes soient retournées.
Montant de la consigne trop faible
Nous pensons que le montant de la consigne de 15 centimes d’euro sur les canettes est trop faible. La consigne sur les canettes est une nouveauté pour les consommateurs et ils doivent s’y habituer. Un montant de consigne suffisant aide les gens à prendre conscience et à adopter de nouveaux comportements. En outre, le gouvernement néerlandais a inscrit dans la loi que 90 % des canettes (et des bouteilles) doivent être rapportées, et un montant de consigne suffisant y contribue.
En ce qui concerne les petites bouteilles en plastique soumises à une consigne de 15 centimes d’euro, moins de 90 % d’entre elles sont encore collectées. En Allemagne, la consigne est de 25 centimes d’euro pour tous les contenants de boissons et 98 % d’entre eux sont rapportés. Au même moment, si moins d’emballages de boissons sont retournés, les supermarchés doivent rendre moins de consigne que ce que les consommateurs payent. Ainsi, des faibles taux de retour se traduisent par des gains financiers pour les entreprises, au détriment des consommateurs.
Les consommateurs devraient pouvoir récupérer leur consigne dans beaucoup plus d’endroits
L’idée de la consigne est qu’en tant que consommateur, vous récupérez votre argent lorsque vous rapportez votre emballage de boisson. Or, ce n’est pas le cas dans de nombreux points de vente, comme les cinémas, les pharmacies et les parcs d’attractions. Dans ces lieux, vous pouvez tout au plus laisser votre bouteille, et bientôt votre canette, dans une poubelle spécifique, mais aucune consigne n’est versée en échange de ce bon comportement. L’industrie inclut ces lieux lorsqu’elle parle des plus de 27 000 points de collecte aux Pays-Bas, mais cela est trompeur car ils ne font pas réellement partie du système de consigne. Le fait qu’à tous les endroits où l’on peut acheter des bouteilles et des canettes, il n’y ait pas de remboursement de la consigne rend difficile pour les consommateurs de récupérer leur argent. C’est une mauvaise chose et cela nuit au fonctionnement du système de consigne – et donc à l’impact environnemental escompté.
Suze Govers : “Le gouvernement est conscient que le système de consigne des bouteilles en plastique ne fonctionne pas suffisamment bien et il est également conscient de ce qui doit changer, mais il ne prend pas les devants. Par conséquent, nous rencontrerons bientôt les mêmes problèmes avec les canettes”.
Retard
Selon la loi, la consigne sur les canettes aurait dû commencer le 31 décembre de l’année dernière. L’industrie avait presque deux ans pour mettre en place le système, mais elle a perdu plus d’un an en explorant d’abord la possibilité d’une collecte à l’extérieur des supermarchés. Peu après que ce plan ait été stoppé sous la pression politique et sociale et que la collecte dans les supermarchés ait été annoncée, l’industrie a déclaré qu’elle manquait de temps et qu’elle n’appliquerait pas la consigne sur les canettes avant le 1er avril 2023. Le gouvernement n’a pas voulu suivre l’annonce de l’industrie, mais a dû plier face à l’industrie, après que le Conseil d’État ait jugé plausible la contrainte temporelle avancée par l’industrie.
La consigne est un dossier de longue haleine aux Pays-Bas. Il n’aura pas fallu moins de 20 ans aux gouvernements successifs pour décider d’étendre la consigne – et, dans un premier temps, uniquement pour les petites bouteilles en plastique. Avec beaucoup d’autres – organisations environnementales, municipalités, organisations de consommateurs, ramasseurs de déchets individuels et membres du Parlement – nous nous battons pour cette expansion en faveur de l’environnment depuis des années. Nous aimerions revenir sur certains des moments qui ont contribué à la décision finale d’introduire également la consigne sur les canettes.
La soupe de plastique ? Les canettes contiennent également du plastique
Lorsque la secrétaire d’État Stientje van Veldhoven (D66) a étendu le système de consigne aux petites bouteilles en plastique en mars 2018, les critiques fusaient sur le fait que les canettes ait été laissées de côté. Van Veldhoven avait alors indiqué qu’elle se concentrait exclusivement sur les bouteilles, principalement en raison de “l’urgence de la soupe au plastique”. Le 1er juillet 2019, Recycling Netwerk publiait une vidéo dans laquelle elle montrait que les canettes contiennent également du plastique. Cela a contribué à remettre la consignes sur les canettes à l’ordre du jour politique.
La souffrance des vaches et le revirement du CDA
Lorsqu’une étude commandée par Recycling Netwerk Benelux a montré que des milliers de vaches tombent malades et meurent chaque année à cause des déchets et que les canettes jouent un rôle majeur dans cette situation, la fédération d’agriculteurs LTO a rejoint l’Alliance pour la Consigne. Ce soutien et ces recherches ont ainsi provoqué un revirement au sein du CDA (Appel chrétien-démocrate), sous l’impulsion de Maurits von Martels, porte-parole de l’économie circulaire et éleveur de vaches laitières. Avec ChristenUnie et D66, le CDA a alors déposé une motion qui a finalement étayé la décision en faveur de la consigne sur les canettes.
L’encouragement social a accéléré la décision
Depuis la fin de l’année 2017, l’Alliance pour la Consigne, qui connaît une croissance très rapide, demande l’introduction de la consigne sur l’ensemble des bouteilles en plastique et canettes. Parmi les plus de 1 300 partenaires se réunissent pas moins de 98 % des municipalités néerlandaises. Lorsqu’il est devenu évident qu’une décision sur les canettes ne serait prise que par le gouvernement suivant, l’Alliance pour la Consigne a lancé une campagne ciblée pour appeler à cette introduction : “La consigne, Yes We Can !“. Les entreprises, organisations et municipalités participantes ont utilisé des affiches colorées pour encourager le gouvernement – et plus particulièrement la secrétaire d’État de l’époque, M. Van Veldhoven – à prendre une décision en faveur de la consigne sur les canettes au cours de cette législature. Dans des vidéos, les députés Cem Laçin (SP), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) et, plus tard, Maurits von Martels (CDA), ainsi que Sandra Molenaar, directrice de l’Association des consommateurs, ont également applaudi Mme Van Veldhoven pour qu’elle prenne elle-même la décision, ce qui s’est produit.
Retrouvez notre analyse ici
Le gouvernement flamand a décidé, juste avant Noël, d’introduire une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes en 2025, en concertation avec les deux autres régions. L’industrie belge de l’emballage promeut un système de consigne “numérique” comme alternative au système classique de consigne où l’on récupère de l’argent dans les supermarchés et autres points de vente. L’organisation environnementale Recycling Netwerk Benelux compare les deux systèmes.
Le ministre de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a pris l’initiative d’introduire un système de consigne sur toutes les bouteilles et canettes en plastique d’ici 2025. Elle a pris cette décision lorsque les chiffres de l’OVAM ont montré que 18,171 tonnes de déchets sauvages doivent encore être nettoyées en Flandre chaque année.
Fin décembre, le gouvernement flamand a donné à l’industrie de l’emballage belge un délai pour tester leur proposition de consigne numérique via des projets pilotes. Avec cette consigne numérique, deux codes par emballage consigné devraient être scannés avant de pouvoir les jeter dans le sac bleu à la maison ou dans des “poubelles bleues publiques”. La ministre a demandé à ce que l’évaluation de ce système soit faite d’ici la fin 2023.
L’objectif final est d’introduire la consigne sur les bouteilles et les canettes en 2025 avec un système qui soit non seulement techniquement réalisable mais aussi accessible à tous. Ce système devra également efficacement réduire radicalement les déchets sauvages et promouvoir un recyclage de haute qualité des matériaux collectés.
La ministre de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) a expliqué que, si le système numérique ne prouve pas être supérieur à un système de consigne classique, c’est ce système classique, avec retour en point de vente, qui sera introduit. Avec ce système, les consommateurs récupèrent leur consigne lorsqu’ils rapportent leurs canettes et bouteilles vides en points de vente. L’OVAM a confirmé les dires de la ministre dans son appel aux entreprises souhaitant jouer un rôle dans la mise en place du système.
Un système de consigne numérique n’a encore jamais été mis en place dans le monde. Il n’y a pas d’exemple pratique pour savoir si et comment il fonctionnerait. Il n’y a pas non plus de données empiriques démontrant que ce système pourrait permettre d’obtenir les mêmes résultats que la consigne classique. Il existe peu d’études sur le sujet, dont l’étude “Every Packaging Counts – DDRS Blueprint” que l’industrie belge de l’emballage a commandée à PricewaterhouseCoopers (PwC).
Cette étude a été livrée à l’industrie de l’emballage à la fin du mois de septembre 2022. Cette dernière l’a alors gardée secrète. Ce n’est qu’après la décision d’introduction du gouvernement et sous la pression de l’opposition et des médias que la ministre Demir a fait en sorte que l’étude soit rendue publique, le 13 janvier 2023, trois semaines après la décision du gouvernement flamand.
Nous avons analysé cette étude sur la consigne numérique. L’industrie de l’emballage a demandé au bureau de conseil PwC de produire une étude qui pourrait “servir d’argument clair et chiffré expliquant pourquoi cette approche est meilleure que le système de consigne classique”. C’est pourquoi nous portons également un regard critique sur l’étude, en soulignant ses limites et les questions qui doivent toujours être résolues.
Notre analyse présente les deux systèmes, y compris leurs coûts respectifs et leur planning de mise en place. Nous posons la question de savoir si ce système numérique peut être aussi efficace que le système classique en termes de réduction des déchets, de taux de retour de matériaux de haute qualité et du potentiel de réemploi. Pour l’essentiel, l’étude PwC ne prouve pas que l’introduction d’une consigne numérique est réalisable à l’horizon 2025 (au contraire). L’étude PwC ne démontre pas non plus que le système de scan permettrait de réduire efficacement les déchets sauvages (ce que la consigne classique a prouvé).
D’une part, notre analyse met en avant les nombreux risques pour les consommateurs: exclusion des personnes qui n’ont pas accès à Internet , ou à un compte en banque. Seulement la moitié de la population belge dispose des compétences numériques nécessaires. La nécessité de partager des données personnelles, les risques de fraudes ou de mauvaise utilisation du système sont également problématiques pour les utilisateurs. Ces obstacles mettent en danger l’adhésion au système, et donc son succès.
Plus largement, notre analyse souligne que la consigne numérique ne répond pas aux objectifs d’amélioration de la qualité du recyclage, ou d’alignement avec les standards européens vers le réemploi. Cela est très problématique car l’Europe prévoit une évolution rapide vers une économie plus circulaire au niveau européen. L’impact sur les déchets sauvages, n’est pas non plus démontré. Cela alors que, la lutte contre les déchets sauvages était le point de départ de la ministre Zuhal Demir quand elle a annoncé le système de consigne
L’étude PWC montre finalement qu’un système numérique nécessiterait une contribution importante des municipalités belges. Que ce soit pour la mise en place de plus de 136 000 poubelles publiques supplémentaires ou la gestion éventuelle de home-scanners pour les ménages.
Notre analyse montre que la faisabilité du système numérique est loin d’être prouvée. Par conséquent, il est irréaliste de penser que la consigne numérique pourrait être lancée dans le temps imparti, c’est-à-dire pour une introduction en 2025. De nombreux éléments doivent encore être mis au point : L’analyse coûts-avantages manque de données et comporte des calculs incorrects, et la couche de gouvernance de l’étude est absente.
Plus inquiétant encore, l’étude de PwC ne démontre pas que le système numérique permettrait d’atteindre les objectifs visés, à savoir la réduction des déchets sauvages et l’amélioration de la qualité du recyclage. Pourquoi mettre en place un système numérique dont l’efficacité n’est pas prouvée ? Surtout quand le système traditionnel fonctionne et est mis en place dans toute une série de pays européens.
Enfin, ce système ne semble pas être accessible à tous les consommateurs et fait peser une charge financière et organisationnelle inutile sur les municipalités.
Le détail des éléments cités ci-dessus est à retrouver dans notre analyse complète ici.
Avec le Black Friday et les achats de Noël derrière nous, nous avons une fois de plus vu défiler de nombreuses offres. De nombreuses marques de vêtements ont également tenté de nous convaincre des “meilleures affaires” et des “plus belles tenues de Noël”. Cependant, l’industrie textile (européenne) (vêtements, chaussures et textiles ménagers) a un impact négatif considérable. Après l’alimentation, le logement et la mobilité, l’industrie textile est la plus nuisible au climat et à l’environnement. Cependant, la quantité de vêtements que nous consommons en Europe a augmenté de 40 % au cours des dernières décennies. Dans le même temps, la qualité de ces vêtements s’est rapidement détériorée et leur composition a changé. Une proportion croissante de nos vêtements est fabriquée en tissus synthétiques, tels que le polyester, l’acrylique et le polyamide. La production de ces tissus nécessite des ressources non renouvelables telles que le pétrole et le gaz. Actuellement, l’industrie textile consomme environ 1,35% de la consommation mondiale de pétrole. Cela peut sembler peu, mais c’est plus que la consommation annuelle totale de pétrole d’un pays comme l’Espagne. D’autres tissus sont encore très dommageables pour la planète ; par exemple, la production de coton nécessite beaucoup de terres et d’eau – environ 2 500 litres pour une chemise – et l’industrie du coton utilise beaucoup de pesticides (remarque : cela ne s’applique pas au coton biologique).
Ainsi, si les matières synthétiques ne sont pas les seules coupables au sein de l’industrie textile polluante, leur prolifération est problématique. Parce que les tissus synthétiques sont moins chers à produire et parce que la production peut être mise à l’échelle relativement facilement, ces tissus sont l’un des moteurs de la fast fashion. Les vêtements synthétiques bon marché sont plus facilement jetés (en moyenne après 7 à 8 utilisations), se dégradent plus rapidement et libèrent de grandes quantités de microplastiques. Et nous sommes encore loin d’un changement de situation : la part des tissus synthétiques ne devrait qu’augmenter dans les années à venir (voir figure 1).

Figure 1 – Production mondiale de fibres par type entre 1980-2030 – Source
Il est clair que l’industrie textile est encore loin d’être durable en ce qui concerne les matières premières. Actuellement, seul environ 1% des textiles collectés sont recyclés en nouvelles fibres textiles (voir figure 2). Cela signifie que 99 % de nos textiles finissent dans des incinérateurs, des décharges ou ailleurs. En 2015, cela représentait quelque 500 milliards de dollars de ressources gaspillées. Dans le même temps, la fast-fashion et bon marché ne fait qu’accroître la montagne de déchets et le recyclage de fibre à fibre des tissus synthétiques est encore plus difficile que celui des tissus naturels.

Figure 2 – Flux mondiaux de matières pour l’habillement en 2015 – Source
Notre consommation de textile et l’utilisation de matières premières vierges pour sa production doivent être réduites de manière drastique, mais comment ? Tant en Europe qu’aux Pays-Bas, des efforts sont faits pour traiter les textiles de manière plus durable. Par exemple, la stratégie européenne pour des textiles durables et circulaires prévoit de s’attaquer à la fast-fashion, de mieux collecter et traiter les textiles jetés à la poubelle, de lutter contre la destruction des textiles invendus et de se concentrer sur des textiles qui durent plus longtemps, sont réutilisables, réparables et recyclables. Cela se fait, entre autres, par l’introduction de la REP sur les textiles, dans le cadre de la révision de la directive-cadre sur les déchets. Toutefois, l’expérience acquise dans d’autres domaines d’action, comme les emballages, montre que la transformation de ces idées (ambitieuses) en propositions concrètes aboutit souvent des ambitions moindre que celle espérées.
Les Pays-Bas réglementent également le secteur du textile : la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les producteurs de textile s’appliquera à partir de 2023. En raison d’un avis tardif du Conseil d’État, l’introduction a été reportée du 1er janvier 2023 à plus tard dans l’année. Même dans ce schéma, le niveau d’ambition est décevant. Comme nous l’avons écrit l’année dernière, les objectifs combinés déclarés pour la réutilisation et le recyclage (de fibre à fibre) donnent une image déformée du niveau d’ambition, la prévention est complètement absente (alors que la directive-cadre sur les déchets l’exige) et nous savons maintenant que la gouvernance défaillante des systèmes REP nuit sérieusement à leur efficacité. Cela a été récemment réaffirmé lorsque l’organisation REP pour l’emballage a saboté l’introduction souhaitable de la consigne sur les canettes.
L’avis du Conseil d’État (RvS) sur la REP pour les textiles, publié en décembre, aborde globalement quatre questions : 1) les détails concrets de la collecte et du traitement des textiles dans le cadre de la REP, 2) les relations entre la responsabilité des producteurs et des autres parties prenantes, 3) la nécessité d’établir une REP pour garantir l’applicabilité, et 4) le point de mesure des objectifs.
Le Conseil demande au ministère des infrastructures et de la gestion de l’eau d’expliciter ce à quoi ressemblera le “système global de collecte des textiles avec l’introduction de la REP”. Une attention particulière doit être accordée ici à la définition de toutes les responsabilités et à la manière dont elles sont liées les unes aux autres. Le Conseil d’État estime qu’il est insuffisant de supposer qu’imposer des obligations légales conduira automatiquement à un système REP efficace. Le Conseil d’État se réfère ici à l’article 8 bis de la directive-cadre sur les déchets. Bien qu’il s’agisse là d’un point important, le Conseil d’État aurait également dû faire référence à l’article 8 bis (6) de la directive-cadre, qui oblige les États membres à assurer un dialogue régulier entre un large groupe d’acteurs impliqués dans un système REP, y compris les producteurs, les autorités locales et les organisations de la société civile. Compte tenu de l’absence de cette disposition dans les systèmes REP actuels, la REP textile devraient inclure une disposition qui la consacre correctement. L’absence de cette possibilité de dialogue élargi a pour conséquence que les organisations de la REP représentent désormais principalement les intérêts des producteurs. Compte tenu de la faible transparence, elles ne sont plus très responsables à cet égard.
La RvS suggère également d’inclure dans l’explication qu’une organisation de producteurs (PRO) est établie en temps opportun (au début de la REP) car l’applicabilité et la faisabilité sont compromises sans une telle organisation. S’il est vrai qu’une organisation de producteurs facilite le respect des règles, c’est ignorer le fait qu’en raison d’un manque de bonne gouvernance, les organisations de producteurs se transforment en lobbys précisément à cause de la législation. C’est une autre raison pour laquelle la REP textile doit établir les cadres adéquats pour le bon fonctionnement d’une organisation de producteurs.
Enfin, l’avis aborde le point de mesure des objectifs. Le rapport de recherche du Rebel Group recommande de mesurer les objectifs par rapport au nombre de kilogrammes de textiles jetés. Pourtant, le ministère a choisi de demander à l’industrie de rendre compte des kilos de textiles mis sur le marché. La RvS souligne que l’ILT (Inspection de l’environnement et des transports) indique dans son test d’application que ces chiffres sont susceptibles d’être frauduleux, car les producteurs pourraient potentiellement manipuler les chiffres. Nous avons indiqué précédemment que dans le cadre des systèmes REP, le gouvernement se met dans une position où il dépend des données fournies par l’industrie. Cependant, cela s’applique non seulement aux rapports faits par les entreprises individuelles, mais aussi aux organisations de producteurs qui rapportent au nom des entreprises.
Enfin, il convient de mentionner la note d’information Kleding – Een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie : van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie de Kiki Hagen (D66). Cette note présente plusieurs propositions que D66 estime nécessaires pour une industrie du textile plus durable. Nous mettons en évidence certaines de ces propositions ci-dessous.
Une transparence radicale
Le document fait valoir que les déclarations de durabilité sont souvent infondées, ce qui fait qu’il est difficile pour les consommateurs de savoir où elles en sont. La proposition de Kiki Hagen consiste à imposer des exigences normalisées aux produits textile, en définissant ce qui est durable et ce qui ne l’est pas. En outre, les informations devraient être disponibles non seulement sur la durabilité d’une ligne particulière (comme les produits Conscious de H&M), mais aussi sur la durabilité de l’entreprise dans son ensemble. Enfin, D66 propose également un éco-score (comme le nutri-score), des amendes plus élevées pour le greenwashing et une obligation d’information concernant les politiques de retour.
RNB pense que ces propositions constitueraient un grand pas dans la bonne direction. Un manque de transparence – en termes de revendications, de chiffres de production et d’utilisation des matériaux – combiné à la volonté de faire le plus de profits possible, entrave la transition vers une industrie textile durable.
Une plus grande responsabilité pour les producteurs
Pour lutter contre la fast fashion, D66 souhaite que les producteurs soient incités, via des systèmes REP, à revoir leur processus de conception. Cela peut se faire en augmentant les taxes que les producteurs versent aux organisations REP pour les produits non durables, en intégrant le droit à la réparation. Mais aussi en créant un rôle plus actif pour au Rijksoverheid en tant que chef de discussion lorsqu’il s’agit de dépenser des fonds, et en donnant aux autres parties prenantes (telles que les municipalités) plus d’influence et de parole. La directive sur l’écoconception sur laquelle l’Europe travaille joue également un rôle important. Il convient d’examiner, entre autres, l’origine des matériaux, leur caractère renouvelable, l’utilisation de pesticides et de produits chimiques et l’élimination progressive des matériaux fossiles (non recyclés).
Outre ces points, le document d’information traite également de la lutte contre la pollution par les microplastiques et de la promotion des chaînes circulaires par un meilleur soutien aux leaders du domaine du durable.
En tant qu’organisation environnementale, nous sommes très heureux de la note d’initiative de D66. Outre les points mentionnés ci-dessus, nous pensons qu’un plan clair de prévention des produits – et donc de l’utilisation de matières premières vierges – fait toujours défaut. Cela s’applique à la politique nationale et internationale et devrait également être inclus dans la définition d’un article ou d’un processus de production “durable”. La durabilité devrait être mesurée, entre autres, par la mesure dans laquelle les matières premières vierges sont évitées. Un vêtement qui n’est pas produit et donc pas acheté par les consommateurs est en fin de compte la solution la plus durable. Pour remédier à la gouvernance défaillante des systèmes REP aux niveaux national et international, nous nous engageons à :
L’organisation environnementale Recycling Netwerk Benelux soutient la décision du gouvernement flamand de mettre en place, en concertation avec les deux autres régions, un système de consigne qui soit opérationnel d’ici à 2025. Il souhaite introduire une consigne de 20 à 25 centimes d’euro sur toutes les bouteilles en plastique et les canettes jusqu’à 3 litres.
Cependant, le choix du gouvernement flamand de donner la possibilité, en 2023, à l’industrie de tester, via des projets pilotes, leur système de scan constitue un risque très important de retard, de report et d’annulation. Avec ce système, pour pouvoir récupérer leur consigne, les consommateurs devraient scanner les QR-codes présents sur leurs emballages ainsi que sur le sac bleu. Il aurait été préférable d’opter immédiatement pour un système clair et simple en exigeant des points de vente, avec une obligation de reprise, qu’ils rendent aux consommateurs leur consigne.
Pour éviter tout retard, nous demandons au gouvernement flamand de s’assurer que le système de consigne puisse effectivement démarrer en 2025. Pour cela, parallèlement aux tests qui seront menés par l’industrie, le gouvernement doit élaborer un plan solide pour un système de Retour en point de vente (Return-to-retail). La participation et la concertation avec les parties prenantes sociétales telles que les municipalités, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales est cruciale. Cela aussi bien pour les tests du système de scan, que pour l’élaboration d’un système avec retour en point de vente.
Des études montrent que le système de scan proposé par le secteur de l’emballage n’est pas encore prêt à être utilisé. Il n’existe encore nulle part dans le monde de système de consigne permettant aux consommateurs de récupérer leur argent via des QR-codes. On ne sait pas quand, ou même si, la technologie sera prête à être mise sur le marché.
Selon Statistiek Vlaanderen, 46 % des Flamands ne possèdent pas de compétences numériques de base. Il y a donc un risque certain que de nombreuses personnes aient des difficultés à récupérer leur consigne avec un système de QR-code qui nécessite un smartphone. Outre un smartphone, des “home scanners” pourraient être utilisés pour permettre de récupérer la consigne, mais ils nécessiteraient eux aussi l’accès à une connexion internet ainsi que le lien à un compte en banque. Des questions sur la manière dont les consommateurs pourront récupérer leur argent et sur les garanties de protection de la vie privée demeurent.
Il existe également des défis techniques : la technologie permettant d’imprimer à grande vitesse des QR-codes individuels sur des canettes doit encore être inventée. Un système complètement nouveau et complexe doit également être mis en place au niveau informatique. Il reste donc de nombreuses questions fondamentales à résoudre d’ici à la fin de 2023.
La question est également de savoir si le plan est conforme au plan européen concernant le règlement sur les emballages et les déchets d’emballages. Le 30 novembre, la Commission européenne a en effet présenté le nouveau règlement qui vise, entre autres, à encourager les emballages réutilisables. Le futur système belge devra donc aussi permettre le réemploi des emballages de boisson.
Les milieux d’affaires ont commandé une étude à PriceWaterhouseCoopers et ont fait pression, sur la base de cette étude, pour un système numérique. Mais ils refusent de rendre cette étude publique. Il est important que la collecte de données et les recherches menées par l’industrie, qui se poursuivront en 2023, soient davantage transparentes. Cela pour permettre une prise de décision pour un système de consigne qui se fasse en toutes connaissances de cause.
Les systèmes de consigne, qui ont fait leurs preuves, avec collecte au point de vente, existent depuis des années dans 48 régions du monde. Ils prouvent chaque jour que ce type de système fonctionne. Pour ce système, il n’y pas besoin d’études supplémentaires nécessaires concernant le fonctionnement technique, les problèmes de confidentialité ou les risques de “fracture numérique”.
Nous continuons donc à demander aux ministres de l’environnement des trois régions de mettre en place un système de consigne qui a fait ses preuves, qui fonctionne efficacement contre les déchets sauvages, permet un recyclage de qualité et permet le réemploi. Selon nous, cela passe encore par la collecte via les supermarchés et les points de vente, comme dans tous les autres pays où la consigne est efficace.
Le Conseil d’État a déclaré aujourd’hui qu’il jugeait “plausible” que des problèmes informatiques empêchent l’industrie de respecter la date légale de début de la consigne sur les canettes. C’est pourquoi les sanctions préventives de l’Inspection de l’environnement et des transports néerlandais (ILT) ne seront pas appliquées. La secrétaire d’État Vivianne Heijnen a déclaré à maintes reprises que la date de début légale est fixe et que les entreprises ne peuvent pas s’en écarter. Cette décision de justice montre maintenant que le gouvernement ne forcera pas les entreprises à respecter la loi.
L’organisation environnementale Recycling Netwerk répond : “Malgré un temps de préparation de près de deux ans, les milieux d’affaires ne sont pas prêts à ajouter les canettes au système de consigne pour le 31 décembre. En général, les pays qui mettent en place une consigne introduisent le système complet [sur tous les emballages concernés] en un an. Ce retard montre l’absence totale de succès de la part des entreprises néerlandaises. De plus, après l’arrêt rendu aujourd’hui par le Conseil d’État, il semble que les milieux d’affaires pourront désormais s’en tirer sans être pénalisés.”
Hier encore, la secrétaire d’État aux infrastructures et à la gestion de l’eau, Vivianne Heijnen, a déclaré à la Chambre des Représentants : “Selon moi, ils ont eu largement le temps de se préparer. Maintenant, ils indiquent qu’ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent s’y opposer et faire appel ou engager une action en justice. Le message du ministère est clair : le 31 décembre, le système entrera tout simplement en vigueur.”
Toutefois, la décision du Conseil d’État montre que la secrétaire d’État ne parvient pas à faire respecter la loi par les entreprises. Recycling Netwerk Benelux a pourtant averti la secrétaire d’État et le ministère à plusieurs reprises depuis la publication du projet de loi (2019). Cela en leur indiquant que la loi n’est pas assez solide juridiquement pour forcer une introduction correcte de la consigne.
L’organisation de défense de l’environnement RNB attend désormais de la secrétaire d’État qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour respecter ses engagements envers la Chambre des représentants. Ce faisant, elle doit également tout mettre en œuvre, avec l’ILT, pour éviter tout nouveau retard, au-delà du 1er avril. L’avocat d’InBev avait déjà fait allusion à une ” période de transition jusqu’au 1er juillet ” lors de l’affaire devant le Conseil d’État. Nous attendons maintenant qu’ILT veille à ce que l’introduction au 1er avril soit définitivement garantie. L’ILT peut le faire en imposant un ordre sous astreinte avec un délai de grâce allant du 1er avril au 31 décembre 2022.
Recycling Netwerk conclut : “Les entreprises annoncent qu’elles ne vont pas respecter la loi, et le gouvernement ne peut apparemment rien y faire. Cela ne fait pas de sens. Nous demandons donc aux responsables politiques d’en tirer les leçons. Le cabinet et la Chambre des Représentants devraient reconsidérer la manière dont ils assurent la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Le cabinet s’est contenté de fixer des objectifs et donne ensuite une confiance aveugle à l’industrie pour qu’elle applique les accords et la loi. Mais nous l’avons signalé à plusieurs reprises : les entreprises font souvent preuve de mauvaise volonté. Il est temps que le gouvernement reprenne les rênes et élabore une meilleure législation. Il faut imposer une législation environnementale, et les relations avec les entreprises ne mènent qu’à de mauvais résultats”.
Le 3 février 2021, Stientje van Veldhoven, alors secrétaire d’État aux infrastructures et à la gestion des eaux, a annoncé qu’il y aurait une consigne sur les canettes. La date de début a été fixée par la loi au 31 décembre 2022. Les entreprises ont donc eu une période de mise en œuvre de 1 an et 10 mois. Ce délai est exceptionnellement long : dans d’autres pays, les entreprises ne disposent en moyenne que d’un an pour mettre en place un système de consigne entièrement nouveau. Aux Pays-Bas, les entreprises n’ont eu qu’à ajouter les canettes au système de consigne existant pour les bouteilles en plastique et les bouteilles de bière en verre.
Après avoir perdu du temps pendant près d’un an avec une idée irréalisable de collecte des canettes à l’extérieur des supermarchés parce que les détaillants ne souhaitaient pas collecter les canettes.
Le Afvalfonds a déclaré unilatéralement en juin 2022 qu’il ne lancerait le système de consigne pour les canettes qu’à partir du 1er avril 2023, c’est-à-dire trois mois après la date d’introduction légale. Le Afvalfonds n’a pas le pouvoir de changer les dates prévues par la loi. Ainsi, l’industrie a donc simplement annoncé qu’elle allait délibérément enfreindre la loi.
L’Inspection de l’environnement et des transports (ILT) a rédigé des ordonnances d’astreinte préventives le 30 septembre 2022 parce que les milieux d’affaires ne prenait “pas de mesures suffisantes” pour respecter le délai et “n’ont pas fourni d’éléments suffisants justifiant un report au 1er avril 2023“. Ces astreintes devaient prendre effet au 31 décembre et pouvaient atteindre 28 millions d’euros. Mais les milieux d’affaires ont riposté. En réponse, l’ILT a suspendu les astreintes jusqu’au 3 février 2021.
Cela signifie que les entreprises pourraient enfreindre la loi pendant au moins un mois sans conséquences négatives. Pour empêcher cela, Recycling Netwerk, représenté par Hörchner Advocaten, est allé au Conseil d’Etat. En l’occurrence, l’affaire lui a été soumise jeudi dernier, le 24 novembre.
Précédents rapports des médias :
Trouw, Le report de la consigne sur les canettes est un “doigt d’honneur au gouvernement”.
La commission de l’environnement a adopté aujourd’hui la proposition révisée du Waste Shipment Regulation par 76 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Le mouvement environnemental européen, dont Rethink Plastic et BFFP, a travaillé sans relâche ces dernières années pour convaincre la commission de l’environnement de la nécessité de cette interdiction.
Pendant des décennies, les États membres de l’Union européenne ont exporté la plupart de leurs déchets vers la Chine. Cette situation a pris fin en 2018 lorsque la Chine a imposé une interdiction d’importation. En conséquence, les exportations européennes de déchets se sont déplacées vers les pays d’Asie du Sud-Est et plus récemment vers la Turquie. L’Europe exporte encore une grande quantité de déchets vers d’autres continents : 32,7 millions de tonnes en 2020. En ce qui concerne spécifiquement les déchets plastiques, ils représentaient 1 135 millions de kilos en 2021, dont 43 % dans les pays non membres de l’OCDE et 35 % en Turquie. Depuis, certains États membres européens n’ont fait qu’augmenter leurs exportations de déchets plastiques.
Le texte adopté aujourd’hui par la commission de l’environnement stipule qu’il n’est plus possible d’exporter des déchets plastiques vers des pays non membres de l’OCDE. Les exportations de déchets plastiques vers les pays de l’OCDE doivent également être supprimées dans un délai de quatre ans.
Le rapport envisage également d’interdire l’exportation de déchets dangereux vers des pays non membres de l’OCDE. Cela implique davantage de flux de déchets que les déchets plastiques seuls. L’exportation de déchets non dangereux vers des pays non membres de l’OCDE ne serait autorisée que si ces pays donnent leur consentement et démontrent qu’ils peuvent les éliminer de manière durable.
L’organisation environnementale Recycling Netwerk Benelux demande depuis des années l’interdiction de ces exportations. C’est une très bonne chose que la commission de l’environnement propose cette interdiction, cela pour deux raisons.
Une interdiction d’exportation garantit que le plastique (précieux) reste en Europe. Cela donne un coup de pouce au secteur européen du recyclage. C’est nécessaire pour le succès de l’économie circulaire européenne, car nous avons de plus en plus besoin de matériaux recyclés. De cette façon, nous réduisons également notre dépendance à l’égard des matières premières vierges. Le réglement sur les emballages présenté le 30 novembre (Règlement sur les Emballages et les Déchets d’Emballages) contient des objectifs en matière de contenu recyclé. Cela signifie que dans les années à venir, les différents types d’emballages en PET devront contenir entre 10% et 30% de matériaux recyclés. Toutefois, ce matériel doit être disponible en Europe. C’est pourquoi il est important d’augmenter la capacité de recyclage des différents types de plastique en Europe. L’interdiction des exportations encourage le marché à travailler à l’augmentation de cette capacité.
L’interdiction comporte également un aspect éthique. Le transport de déchets plastiques des pays européens riches vers les pays pauvres a de lourdes conséquences pour la population locale. L’impact environnemental ainsi que l’impact négatif sur la santé sont énormes, comme l’ont montré les recherches de l’Agence d’investigation environnementale.
La grande majorité des exportations s’effectue sous la rubrique “recyclage”. Mais les données montrent qu’il existe un écart important entre la capacité de recyclage des pays bénéficiaires et la quantité de déchets plastiques provenant de l’étranger. Prenons l’exemple de la Malaisie : le pays produit lui-même 2,4 millions de tonnes de plastique par an. Elle importe en moyenne 835 000 tonnes. Cependant, les installations de recyclage de Malaisie n’ont une capacité que de 515 009 tonnes. Le résultat ? On ne sait pas ce qu’il advient des 2,7 millions de tonnes restantes ; elles finissent dans des décharges illégales, sont brûlées illégalement ou disparaissent dans une décharge. Les conséquences pour la population locale sont énormes : elle est exposée à des substances toxiques qui se répandent dans l’eau, le sol et l’air, et la quantité de microplastiques dans la chaîne alimentaire augmente.
Recycling Netwerk Benelux estime qu’il n’est ni durable ni éthique que l’Europe expédie ses déchets vers des pays qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires à leur traitement, afin qu’au moins nous, en Europe, n’ayons plus à nous en occuper. Nous nous félicitons donc de l’interdiction d’exportation.
Le rapport de la commission de l’environnement devrait être soumis au vote de la plénière du Parlement européen en janvier 2023. L’organisation environnementale Recycling Netwerk appelle déjà la Commission européenne et les représentants des États membres à soutenir pleinement ces règles plus strictes en matière d’exportation de déchets.
*La Belgique et les Pays-Bas sont d’ailleurs en tête du classement mondial des exportations de déchets plastiques. La Belgique représente 4,2 % et les Pays-Bas 5,6 % du commerce mondial de déchets plastiques. Ils exportent donc plus de déchets que des pays comme la France, l’Espagne, le Canada ou le Mexique (Université de Harvard, The Atlas of Economic Complexity).
Vous avez une question sur cet article ? Alors, contactez Janine à janine.roling@recyclingnetwerk.org
En 2020, il y avait en moyenne 177 kg de déchets d’emballages par Européen, contre 154 kg en 2010. Près de 30 ans après la première législation européenne sur les emballages, la pression exercée par ces derniers sur l’environnement ne fait qu’augmenter.
Pour faire face efficacement à l’impact des emballages sur le climat, la biodiversité et la soupe de plastique, il est nécessaire de mettre en place des politiques qui s’engagent fermement à réduire les emballages et à normaliser les systèmes d’emballage réutilisables. En effet, l’utilisation de matières premières pour les emballages doit diminuer fortement et la dépendance aux ressources fossiles doit être stoppée.
Selon un rapport de Break Free From Plastic, près de 10 % de la consommation de pétrole et de gaz en Europe est consacrée à la production de plastique, dont 40 % environ pour les emballages. Mais il ne s’agit pas seulement de plastique : la production et la consommation irréfléchies d’emballages jetables en papier (50 % de la consommation européenne de papier est destinée aux emballages), en métal, en verre et en bois, doivent être tout autant stoppés.
La proposition de règlement sur les emballages de la Commission ne le fait pas suffisamment. L’intention derrière ce règlement est bonne. Il y est reconnu que des années d’engagement en faveur du recyclage n’ont pas conduit à un changement de tendance suffisant dans notre utilisation des matières premières. C’est pourquoi la Commission formule pour la première fois un objectif de prévention des déchets (article 38) de -5% d’ici 2030, -10% d’ici 2035, pour atteindre -15% de déchets d’emballages générés d’ici 2040.
Il existe deux stratégies pour y parvenir : mettre moins d’emballages sur le marché (supprimer les emballages ou les alléger) ou remplacer les emballages jetables par des emballages réutilisables. La Commission européenne impose ces objectifs aux États membres. Néanmoins elle n’établit pas des règles suffisamment efficaces contre les emballages superflus et inutilement lourds.
Dans le cas des objectifs de réemploi (article 26), il est à nouveau important de noter que l’intention est bonne. Mais après la fuite, au début du mois, d’un projet de règlement contenant des objectifs nettement plus élevés, la déception est grande. Les objectifs publiés aujourd’hui montrent que la Commission a sans doute succombé à la pression de divers milieux industriels : les objectifs de réemploi pour 2030 et ceux pour 2040 ont été fortement édulcorés. L’industrie de l’emballage a réagi de manière exagérément hostile aux propositions de la Commission. Nous appelons donc l’industrie de l’emballage à poursuivre la transition vers le réemploi. La mentalité du jetable doit changer une fois pour toutes afin de réduire considérablement l’impact environnemental des emballages.
Dans les questions et réponses accompagnant la PPWR, il est indiqué que toutes les mesures combinées permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 43 millions de tonnes en 2030, contre 66 millions de tonnes dans un scénario de statu quo, ce qui mettra le secteur sur la voie de la neutralité climatique d’ici 2050. Cette dernière conclusion n’est pas étayée.
Si la direction est bonne, les mesures ne sont pas alignées avec le degré d’urgence requis. Nous demandons donc avec urgence à la Commission européenne, au Conseil européen et au Parlement européen d’adopter des politiques conformes aux engagements pris pour réellement limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré maximum.
Nous publierons un document de synthèse contenant une analyse complète de la législation dans quelques semaines. Ci-dessous, nous proposons déjà une brève réaction à certains des principaux aspects de la législation.
En 2014, la Commission européenne a procédé à un “contrôle d’aptitude” qui a révélé que les exigences essentielles (EE, en anglais “Essential Requirements”) devaient être rendues plus concrètes et plus contraignantes. Les EE (également connu sous le nom d’annexe II de la législation encore en vigueur) vise à fixer des limites sur les emballages afin d’éviter (entre autres) l’utilisation superflue de matériaux. La réduction de l’utilisation d’emballage est le moyen le plus efficace de réduire son impact sur l’environnement. Les décideurs politiques sont également tenus par la directive-cadre sur les déchets de faire de la réduction une priorité.
Dans la pratique, les EE n’ont pas encore eu d’effet car 1) les critères sont formulés de manière si générale qu’il est difficile d’intervenir concrètement, et 2) le mécanisme de contrôle est lourd et fait peser une charge disproportionnée sur les inspections environnementales nationales. En effet, pour intervenir sur un emballage non conforme, il faut demander le dossier du produit au fabricant. À la suite de quoi un échange d’informations, d’avis, d’avertissements et de promesses doit avoir lieu. Un tel processus peut rapidement prendre des mois, voire des années. En 2019, nous avions par exemple constaté que de nombreux emballages d’assouplissants, de bouteilles de shampoing et de spiritueux étaient souvent des dizaines, voire des centaines de fois trop lourds. Trois ans plus tard (avec des demandes répétées d’application de la loi auprès de l’Inspection de l’environnement et des transports néerlandaise), un seul fabricant a décidé de modifier son emballage: Le Johnnie Walker Blue Label ne pèse plus 1399 grammes, mais 882 grammes, tandis que le Johnnie Walker Blender’s Batch ne pèse que 355 grammes.
Les nouvelles propositions d’Exigences Essentielles (article 9 et annexe IV) ne changent pas grand-chose à cette situation. Par exemple, les producteurs ne seront plus autorisés à indiquer dans leurs dossier produit que le “marketing” ou le “désir du consommateur” justifie l’utilisation d’un emballage supplémentaire, comme il est actuellement possible s’ils suivent la norme EN 13427. Mais il est assez facile de contourner ce problème en déclarant, par exemple, que la quantité d’emballage supplémentaire est nécessaire pour la protection pendant le transport.
Plus fondamentalement, le contrôle et l’application de ces mesures restent une tâche bien trop importante et donc impossible pour les agences gouvernementales nationales. Ainsi, la législation ne sera tout simplement pas applicable.
Des règles claires sont nécessaires pour les emballages dont le poids maximal est fonction du contenu et adapté au matériau d’emballage utilisé : une bouteille de vin en verre, par exemple, ne doit pas peser plus de 350 grammes. Des règles aussi claires permettraient enfin aux inspecteurs de l’environnement d’intervenir de manière décisive. La Commission européenne ignore à présent la mesure environnementale la plus simple et la plus importante qu’elle puisse prendre.
Il y a néanmoins quelques points positifs : les emballages en plastique jetables pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg seront interdits (sauf si leur utilité est prouvée), les emballages en plastique jetables pour les aliments, les boissons et, par exemple, les mini-portions de sauce dans les établissements de restauration seront interdits, tout comme les petites bouteilles de shampoing en plastique que l’on trouve dans les hôtels.
Outre l’interdiction des produits susmentionnés, des objectifs de réemploi ont également été fixés pour divers groupes de produits. Le passage des emballages à usage unique aux emballages réutilisables contribue directement à la prévention de la consommation des ressources. Après tout, un gobelet utilisé plusieurs fois évite de nombreux gobelets jetables en plastique ou en papier. Ce changement est donc crucial pour réduire l’impact environnemental des emballages.
C’est également ainsi que la Commission interprète le réemploi dans la présente proposition. La considération 62 demande des exigences minimales pour les systèmes de réemploi en boucle ouverte / boucle fermée. De cette manière, la Commission veut empêcher la mise sur le marché de divers emballages qui sont théoriquement réutilisables, mais qui, dans la pratique, ne sont pas réutilisés par les consommateurs. La Commission fait également référence aux emballages ‘rechargeables’ (refill) dans la considération 65. La différence entre l’emballage réutilisable et rechargeables semble être qu’un produit est proposé à la vente dans un emballage réutilisable, ou que le produit est proposé, sans emballage, dans une station de recharge où les consommateurs peuvent alors prendre leur propre emballage.
 Une version de la PPWR ayant été divulguée en octobre était ambitieuse en matière de réemploi (voir les visuels 1 et 2). La fuite du document et les objectifs de réemploi relativement élevés ont provoqué une réaction forte et négative de l’industrie. Dans une déclaration commune, publiée par la “European Packaging Value Chain” au nom de plus de 60 fédérations d’entreprises, l’industrie mettait en doute le fait que la Commission ait utilisé une approche fondée sur des données probantes (“Evidence-based“) pour fixer les objectifs. Ils affirmaient que les objectifs étaient irréalistes et disproportionnés. En citant des Analyses de Cycle de Vie (ACV), financées par l’industrie, ils affirmaient que les emballages réutilisables étaient loin d’être la meilleure option pour le climat et l’environnement. L’industrie du papier et du carton citait également des ACV qui – sur la base d’indicateurs choisis de manière opportuniste – mettent en doute le réemploi.
Une version de la PPWR ayant été divulguée en octobre était ambitieuse en matière de réemploi (voir les visuels 1 et 2). La fuite du document et les objectifs de réemploi relativement élevés ont provoqué une réaction forte et négative de l’industrie. Dans une déclaration commune, publiée par la “European Packaging Value Chain” au nom de plus de 60 fédérations d’entreprises, l’industrie mettait en doute le fait que la Commission ait utilisé une approche fondée sur des données probantes (“Evidence-based“) pour fixer les objectifs. Ils affirmaient que les objectifs étaient irréalistes et disproportionnés. En citant des Analyses de Cycle de Vie (ACV), financées par l’industrie, ils affirmaient que les emballages réutilisables étaient loin d’être la meilleure option pour le climat et l’environnement. L’industrie du papier et du carton citait également des ACV qui – sur la base d’indicateurs choisis de manière opportuniste – mettent en doute le réemploi.

Les objectifs publiés aujourd’hui montrent que la Commission a peut-être succombé au lobby de ces secteurs : les objectifs de réemploi pour 2030 ainsi que ceux pour 2040 ont été fortement édulcorés. L’article 26, qui fixe les objectifs de réemploi et de recharge, stipule que le réemploi et la recharge comptent tous deux dans l’atteinte des objectifs pour les boissons et les emballages alimentaires. Cependant, en raison de la formulation vague, il n’est pas immédiatement clair dans quelle mesure la recharge contribue à la prévention des emballages jetables pour le producteur. Nous avons l’intention de clarifier ce point dans une analyse ultérieure.
Lors de la présentation de la proposition, Timmermans et Sinkevičius ont souligné qu’il s’agissait sans aucun doute d’une proposition révolutionnaire et qu’il ne fallait surtout pas perdre de vue l’objectif global de réduction des déchets de 15 % en 2040 par rapport à 2018. Si nous reconnaissons en effet que nous n’avons jamais vu un tel effort européen sur la prévention et le recyclage, le niveau des objectifs et la vitesse à laquelle ils doivent être atteints restent très décevants. La perspective offerte par cette proposition est actuellement si faible que d’ici 2040, l’Europe sera encore loin d’une gestion réellement durable des emballages et des matières premières.
De plus en plus de pays prouvent que les systèmes de consigne sont nécessaires pour lutter contre les déchets sauvages et parvenir à un réemploi des emballages et à un recyclage de qualité. La proposition de règlement stipule qu’à partir de 2029, des systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique et les récipients de boissons en métal doivent être introduits dans toute l’Europe.
Les règles et les exigences minimales sont détaillées à l’article 44 et à l’annexe X du projet PPWR. Les pays peuvent être exemptés d’un système de consigne s’ils prouvent qu’ils collectent séparément plus de 90 % des bouteilles en plastique et des canettes en 2026 et 2027. Aucun pays européen sans système de consigne n’est près d’atteindre ces objectifs.
L’annexe II précise également que les points de vente sont tenus de reprendre les emballages (‘Take-back obligation’) et de rendre leur consigne aux consommateurs. C’est important pour le confort du consommateur, mais aussi pour atteindre et faire respecter les objectifs. En effet, la législation néerlandaise ne formulant pas d’obligation de collecte, l’objectif de collecte de 90 % n’est pas encore atteint et l’introduction de la consigne sur les canettes au 31 décembre 2022 est compromise.
L’obligation de collecte est également importante pour le passage aux emballages réutilisables. La proposition stipule ainsi que les États membres doivent s’efforcer de rendre les systèmes de consigne pour les emballages jetables accessibles également pour les emballages réutilisables.
Les versions précédentes de la législation européenne sur les emballages étaient principalement tournées autour d’objectifs de recyclage encourageant au traitement et à la collecte de plus en plus de déchets d’emballages, mais pas nécessairement valorisés à nouveau. Cela est particulièrement difficile dans le cas des matières plastiques. Les déchets d’emballages plastique sont souvent utilisés dans toutes sortes d’autres produits (de valeur moindre – ‘le downcycling’). Par conséquent, de nombreuses matières premières fossiles sont encore nécessaires et utilisées pour produire de nouveaux emballages en plastique.
La proposition de la Commission tente d’y remédier par le biais de l’article 6 sur la recyclabilité des emballages et de l’article 7 qui fixe des objectifs de “contenu recyclé” pour les emballages en plastique. Selon l’article 6, à partir de 2030, les emballages devront être conçus pour être recyclables et remplacer les matières premières utilisées à l’origine. La proportion obligatoire de contenu recyclé a été fixée comme suit.
À partir de 2030 :
À partir de 2040 :
Les objectifs de contenu recyclé pour 2040 sont ambitieux et entraîneront à terme une révolution majeure dans la conception, la collecte et le recyclage des emballages. Il donnera un grand coup de pouce à l’industrie européenne du recyclage des plastiques. Mais les objectifs pour 2030 sont trop faibles. Cela risque de retarder les investissements et de rendre plus difficile l’atteinte des objectifs de 2040. Les objectifs pour 2030 étaient considérablement plus stricts dans le projet qui a été divulgué.
Fugea, Algemeen Boerensyndicaat, Bond Beter Leefmilieu, Canal It Up, CC-CS, Greenpeace, Herwin, Proper Strandlopers, Natuurpunt, Recycling Netwerk et Test-Achats ont signé une lettre commune à cet effet adressée aux ministres Zuhal Demir (Flandre), Céline Tellier (Wallonie), Alain Maron (Bruxelles), Zakia Khattabi (fédéral) et aux (vice)ministres-présidents des trois régions.
Les signataires demandent que les décrets sur la consigne donnent aux consommateurs le droit de récupérer leur consigne aux points de vente et supermarchés en l’inscrivant dans le texte légal. Ce système de “return-to-retail” est la norme dans les pays où la consigne est un succès. Aucun pays ne parvient à atteindre 90 % de collecte sélective des emballages sans ce modèle. L’obligation de collecte pour le commerce de détail est également importante pour réglementer clairement la répartition sur le plan juridique des responsabilités entre, d’une part, les producteurs de boissons et, d’autre part, les supermarchés et commerces de détail. Un système de collecte aux points de vente permet également de développer le réemploi des emballages.
Les auteurs de la lettre demandent aux ministres de ne pas attendre les études et projets-pilotes que Fost Plus affirme vouloir mener sur un système de scan. Dans ce système de scan, chaque emballage doit être scanné individuellement, ainsi que la poubelle publique ou le sac bleu dans lequel il est jeté. Cela via une application qui doit de plus être liée à un compte en banque, afin que le consommateur puisse prétendre récupérer sa consigne.
Il existe par ailleurs des obstacles à la mise en œuvre de ce système. La technologie pour imprimer à grande vitesse des QR-codes uniques sur des canettes n’est pas développée. Des questions se posent aussi sur les risques de fraude et d’atteinte à la vie privée. Les coûts d’un tel système ne sont pas clairs. Il est aussi incertain si le système sera accessible aux personnes qui ne maîtrisent pas la technologie numérique (la fracture numérique) ou même que les gens pourront récupérer leur argent immédiatement. Il n’est ainsi pas certain que ce système numérique corresponde aux souhaits des consommateurs.
Pour l’instant, on ne sait pas encore quand un système de scan pourrait être opérationnel. L’industrie indique qu’elle doit effectuer des recherches et des tests supplémentaires sur la faisabilité d’un tel système de scan. Cela prendrait nécessairement des années car il s’agit de concevoir un système qui n’existe encore nulle part. Il n’est donc pas certain qu’un tel système numérique puisse être mis en place avant la fin de cette décennie.
Les organisations environnementales, d’agriculteurs et de consommateurs donnent les conseils suivants afin que le système de consigne soit le plus efficace possible dans la lutte contre les déchets sauvages :
Les signataires mentionnent également que, si les régions belges peuvent décider indépendamment d’introduire une consigne sur les emballages de boisson, il reste préférable qu’elles décident ensemble des modalités d’un système de consigne pour l’ensemble de la Belgique.
D’après les enseignements tirés d’autres pays de l’Union Européenne qui ont la consigne, l’introduction d’un tel système nécessite environ 12 à 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la législation. En tenant compte des étapes nécessaires à la prise de décision politique, un système de consigne belge complet pourrait être opérationnel d’ici 2025. “Vous avez déjà notre soutien pour sa mise en œuvre”, concluent les organisations dans leur lettre.
Lire la lettre ici.

Knack publiceerde dit opiniestuk op 19 november 2022
La ville d’Anvers a annoncé cette semaine qu’elle ne participerait plus au projet “The Click” de Fost Plus. Il s’agissait de scanner des déchets sauvages ainsi qu’un code QR sur une poubelle publique pour obtenir une monnaie virtuelle, le ‘U-coin’, qui peuvent être échangés dans quelques points de vente. L’évaluation faite par la ville d’Anvers est négative. D’une part, les coûts ont été pris en charge par la ville. D’autres part, en moyenne, il n’y a eu qu’un seul clic tous les deux jours par poubelle. La quantité de déchets dans les rues est restée la même.
Anvers a raison d’y mettre un terme. Il est insensé d’investir du temps et de l’énergie dans des politiques d’allumage qui ne produisent aucun résultat. Le sort du Click est symptomatique des politiques menées ces dernières années. Fost Plus a fait des tests et des “bonnes petites idées ” avec le Click, a envoyé Mooimakers dans les rues et a collé des affiches. Mais l’objectif de réduire de 20 % les déchets d’ici à 2022 est loin d’être atteint. Dans son rapport Zwerfvuil en Sluikstort 2021, OVAM a encore compté 18 millions de kilos de déchets sauvages en Flandre en 2021. Ainsi, après six ans, l’industrie et Fost Plus n’ont pas réussi à atteindre la réduction structurelle prévue par le Plan d’application sur les déchets 2016-2022, l’Accord sur les emballages 2018 et l’Accord de coalition 2019-2024 du gouvernement flamand.
La ministre flamande de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) en conclut logiquement que la consigne est inéluctable. Elle souhaite obtenir une décision du gouvernement flamand avant la fin de l’année afin que la consigne puisse être opérationnelle d’ici 2025. Le CD&V, partenaire de la coalition, ainsi que les partis d’opposition Vooruit et Groen sont depuis longtemps des partisans. Au Parlement wallon, le souhait d’avancer vers la consigne est aussi présent. Même le premier ministre fédéral Alexander De Croo (Open VLD) a exprimé son soutien à la consigne sur RTBF cette semaine. En effet, la lutte contre les déchets sauvages nécessite une approche plus efficace et dont l’impact est prouvé. Ce qui ne fonctionne pas, nous y mettons fin. Ce qui fonctionne bien, nous le mettons en œuvre. C’est donc une bonne chose que la ville d’Anvers arrête Le Click. Et que les gouvernements flamand, bruxellois et wallon prennent des mesures en faveur de la consigne.
Il est donc intéressant de noter que, lorsque la ministre Demir a annoncé qu’elle allait introduire la consigne, Fost Plus a partagé une proposition alternative, similaire au Click : scanner les emballages avec des smartphones. Fost Plus souhaite que les gens soient obligés de scanner les canettes et les bouteilles non seulement dans la rue, mais aussi à la maison avant de les jeter dans le sac bleu. Mais, là encore, le système n’est pas encore au point. La technologie permettant d’imprimer efficacement et à grande vitesse des QR-codes individuels sur des canettes n’existe pas. Fost Plus doit encore faire des années de tests et d’études avant de pouvoir dire si son système peut fonctionner. Un tel système de scan n’existe encore nulle part dans le monde. Aussi, l’échéance de 2025 ne sera jamais respectée.
En dehors de Fost Plus lui-même, il y a peu d’enthousiasme pour cette idée. Au cours des auditions au Parlement flamand, les députés et les parties prenantes ont soulevé de nombreuses questions sur les possibilités de fraude et de violation de la vie privée avec un tel système de scan. Qu’en est-il de quelqu’un qui scanne dans sa voiture son emballage et une photo du QR-code de son sac bleu, et qui jette quand même la canette par la fenêtre ? Quelles données privées sont nécessaires pour permettre la transaction ? Et que dire des personnes qui ont des difficultés à utiliser un smartphone pour scanner les codes QR sur les canettes et le sac bleu ? Seuls 54 % des résidents de la région flamande disposent de compétences numériques de base.
Fost Plus est-il vraiment sérieux à propos de ce système de scan ? Ou s’agit-il d’une tactique de retardement cynique ? En tout cas, ce qui est certain, c’est que le système de consigne connu de tous, avec collecte en point de vente pourrait, lui, être opérationnel d’ici 2025. En revanche, personne ne sait si le système de scan de Fost Plus sera efficace, accessible et s’il est technologiquement réalisable. Allons-nous lutter contre les déchets sauvages avec un outil, la consigne, qui montre quotidiennement ses effets positifs dans plus de 40 États ? Ou la Flandre optera-t-elle pour un concept théorique qui n’existe pas encore ?
 Lors des auditions au Parlement flamand, l’introduction d’un système de consigne où les gens récupèrent leur consigne au supermarché, comme cela existe déjà pour les bouteilles de bière, par exemple, a reçu un large soutien. Les experts d’OVAM ont souligné que le système de consigne devait être simple, facile, convivial et accessible. L’Association des villes et municipalités flamandes (VVSG) a expliqué que c’est le rôle du secteur de la distribution de mettre en place la collecte dans les supermarchés et autres points de vente. L’intention ne peut être d’utiliser l’espace public à cette fin. L’OVAM propose un cadre minimum avec l’obligation pour les moyennes et grandes surfaces de vente de boissons alcoolisées de plus de 400 m2 de surface de vente nette de faire office de canaux de collecte.
Lors des auditions au Parlement flamand, l’introduction d’un système de consigne où les gens récupèrent leur consigne au supermarché, comme cela existe déjà pour les bouteilles de bière, par exemple, a reçu un large soutien. Les experts d’OVAM ont souligné que le système de consigne devait être simple, facile, convivial et accessible. L’Association des villes et municipalités flamandes (VVSG) a expliqué que c’est le rôle du secteur de la distribution de mettre en place la collecte dans les supermarchés et autres points de vente. L’intention ne peut être d’utiliser l’espace public à cette fin. L’OVAM propose un cadre minimum avec l’obligation pour les moyennes et grandes surfaces de vente de boissons alcoolisées de plus de 400 m2 de surface de vente nette de faire office de canaux de collecte.
Les plus de 200 municipalités flamandes et plus de 100 municipalités wallonnes réunies au sein de l’Alliance pour la Consigne attendent un système de consigne qui, avec la collecte via les supermarchés, empêchera réellement les canettes et les bouteilles de finir dans les déchets sauvages. C’est également le souhait de 80 % des Belges qui souhaitent une consigne. Nous pouvons donc espérer que les ministres Demir, Maron et Tellier, avec le soutien de leurs parlements, mettront en place un système de consigne solide et efficace.
La Belgique a pris du retard dans l’introduction de la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Quatorze pays européens nous ont précédés. La Grèce, la Hongrie, le Royaume-Uni, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, l’Irlande du Nord et la Turquie déploieront une consigne d’ici 2025. Mais nous pouvons aussi tirer partie de notre retard. En tirant les leçons des expériences étrangères, nous pouvons créer le meilleur système de consigne en Europe. Une Flandre belle et propre est à portée de main.
Tom Zoete et Chloé Schwizgebel
Recycling Netwerk Benelux
Plus de 18 millions de kilos de déchets sauvages ont été collectés en Flandre en 2021. C’est ce que révèlent les chiffres de l’Agence publique des déchets flamands (OVAM). L’industrie n’a donc pas réussi à atteindre l’objectif de réduction de 20 %. Cette objectif avait été stipulé dans le Plan de mise en œuvre des déchets ménagers et assimilés 2016-2022, l’accord sur les emballages de 2018 et l’Accord de coalition 2019-2024 du gouvernement flamand.
L’Alliance pour la Consigne a immédiatement réagi à la nouvelle ce matin : “Dès le début de son mandat, la ministre Demir a mis en garde le secteur. Maintenant, elle tire la conclusion logique des mauvais chiffres des déchets sauvages et passe à l’action. Après avoir donné des années à l’industrie pour réduire les déchets sauvages par d’autres moyens, l’heure est maintenant venue pour la consigne, le système qui a fait ses preuves depuis des années en Allemagne, aux Pays-Bas et dans des dizaines d’autres pays”.
En Flandre, plus d’un tiers du volume des déchets sauvages est constitué de bouteilles et de canettes en plastique. La consigne peut réduire de 70 à 90 % le nombre de bouteilles et de canettes parmi les déchets sauvages. Un an après l’introduction d’une consigne sur les bouteilles aux Pays-Bas, il y avait déjà 76 % en moins dans la nature. La consigne donne donc lieu à des résultats positifs très rapidement. C’est exactement la raison pour laquelle de plus en plus de pays européens introduisent la consigne. Pour que la consigne fonctionne, elle doit être aussi simple que possible pour les clients, avec des points de collecte dans tous les points de vente, comme c’est le cas actuellement pour les bouteilles en verre consignées.
La ministre Demir a mis l’introduction de la consigne sur la table du gouvernement flamand. Les partenaires de la coalition, le CD&V, ainsi que les partis d’opposition Vooruit et Groen sont depuis longtemps des défenseurs de la consigne.
La ministre Demir a également contacté ses homologues wallons et bruxellois, Céline Tellier et Alain Maron (tous deux d’Ecolo) en faveur de la consigne dans toute la Belgique. Les accords de coalition de la Wallonie et de Bruxelles prévoient tous deux l’introduction de la consigne dans cette législature. La commission de l’environnement du parlement wallon a tenu des auditions pendant des mois et a effectué une visite pour en apprendre plus du système de consigne néerlandais. Un consensus se dessine au sein du Parlement wallon au-delà des différences entre la majorité et l’opposition.
L’Alliance pour la Consigne conclut dans son communiqué de presse : “Nous encourageons les gouvernements régionaux à prendre une décision pour l’introduction de la consigne avant la fin de cette année, comme le propose la ministre Demir. Il est maintenant important de mettre en place un système de consigne convivial qui permette aux gens de rapporter facilement leurs bouteilles et leurs canettes dans les supermarchés et autres points de vente. Avec des décrets fermes sur la consigne et un accord de coopération interrégional, nous pouvons mettre à mal les “déchets sauvages”.
Le 19 Octobre, Vivianne Heijnen, secrétaire d’État aux infrastructures et à la gestion de l’eau, a publié le dernier rapport de suivi du Rijkswaterstaat (Direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux néerlandaise – RWS) sur le nombre d’emballages de boissons parmi les déchets sauvages. Ce rapport montre que RWS a trouvé 53% de petites bouteilles en plastique en moins parmi les déchets sauvages au printemps 2022 par rapport au printemps 2020. Comme de nombreuses mesures exceptionnelles étaient en vigueur au cours de l’année de référence 2020 du fait de la pandémie, la baisse pourrait être un peu plus marquée en réalité[1].
La mesure précédente de RWS a montré une baisse de 41% du nombre de bouteilles parmi les déchets sauvages. La secrétaire d’État Heijnen déclare que ces derniers chiffres “renforcent sa conviction que la consigne est un outil efficace contre les déchets sauvages”. Depuis l’introduction de la consigne, la proportion de petites bouteilles en plastique parmi les déchets sauvages a en effet considérablement diminué. Dirk Groot a communiqué au début de l’année que son suivi montre que la proportion de bouteilles en plastique parmi les déchets sauvages a diminué de 76% depuis l’introduction de la consigne au 1er juillet 2021. La consigne est donc incontestablement plus efficace que toute autre mesure de lutte contre les déchets sauvages. Cependant, ces données montrent également que le potentiel de la consigne dans cette lutte n’est pas optimiser.
Le cabinet d’étude CE Delft a prédit que la consigne pourrait réduire de 70 à 90 % le nombre de bouteilles en plastique parmi les déchets sauvages. Ils se sont basés sur les résultats obtenus dans d’autres pays. Bien que le système n’ait qu’un an, il est clair que nous sommes encore loin des résultats escomptés et on peut en conclure qu’un ajustement du système est nécessaire. Nous avons déjà indiqué dans une évaluation intermédiaire quels sont les facteurs de réussite d’un système de consigne qui fonctionne bien, et quels sont les leviers que le gouvernement et l’industrie peuvent encore utiliser pour améliorer le système de consigne néerlandais. Il s’agit notamment d’augmenter le montant de la consigne, de légiférer pour que les consommateurs puissent récupérer leur consigne dans tous les points de vente, d’éviter les exceptions qui prêtent à confusion et de mener une campagne publique forte et motivante.
Aussi, nous attendons du gouvernement qu’il ne se contente pas d’un système qui atteigne une réduction de seulement 70 % (minimum atteignable selon l’étude de CE Delft) de petites bouteilles dans l’environnement, mais qu’il s’engage aussi à mettre en place un système de consigne qui empêche au maximum que ces bouteilles ne finissent dans la nature. La position actuelle du gouvernement nous fait douter de cette ambition. En effet, la lettre de Heijnen ne montre aucune intention d’ajuster l’impact du système de consigne néerlandais sur les déchets sauvages.
La secrétaire d’État a annoncé aujourd’hui les chiffres relatifs aux déchets sauvages en réponse à une demande du comité IenW qui souhaitait avoir un aperçu des chiffres de la collecte. Ces chiffres de collecte sont également un indicateur important de l’efficacité du système de consigne. En effet, l’impact positif de la consigne sur l’environnement, outre la réduction des déchets sauvages, consiste également en un recyclage plus important et de meilleure qualité, de sorte que moins de matières premières sont utilisées pour les nouvelles bouteilles en plastique mises sur le marché. Les chiffres de la collecte montrent combien de bouteilles sont effectivement retournées via le système de consigne. Ce chiffre ne peut pas être calculé uniquement à partir des données sur les déchets sauvages, car les bouteilles peuvent également se retrouver dans les PMC ou les déchets résiduels.
Cette demande à l’échelle du comité a été initiée par Partij voor de Dieren, qui a déjà demandé à plusieurs reprises à la secrétaire d’État les chiffres relatifs à la collecte. Comme dans sa réponse à Partij voor de Dieren de l’époque, la secrétaire d’État réagit de nouveau négativement à cette demande actuelle du comité. Elle fait référence au mois d’août 2023, date à laquelle elle recevra pour la première fois un aperçu des chiffres de collecte du secteur. À ce moment-là, le système de consigne pour les petites bouteilles en plastique aura été mis en place depuis plus de deux ans. Nous trouvons que le fait que le gouvernement ne veuille pas fournir ces informations lorsque la Chambre basse le demande n’est pas transparent et injustifié. En outre, il est incompréhensible que le gouvernement lui-même ne veuille pas avoir un aperçu intermédiaire de la situation. Cela permettrait de suivre l’évolution de l’atteinte de l’objectif légal de 90% de collecte sélective.
Nous demandons à la secrétaire d’État Heijnen d’honorer encore la demande de la commission et de fournir rapidement à la Chambre basse les chiffres de la collecte des petites bouteilles en plastique. Ensemble, les données sur les déchets sauvages et les chiffres de la collecte permettront à la Chambre basse et au gouvernement de mieux comprendre quels ajustements sont nécessaires pour améliorer le système de consigne néerlandais et optimiser son plein potentiel.
—
[1] Au printemps 2020, de nombreuses mesures corona étaient en place, ce qui signifie que les gens restaient souvent à l’intérieur. En raison de cette année zéro particulière, au cours de laquelle il y avait déjà beaucoup moins de petites bouteilles en plastique dans les déchets sauvages selon les mesures de Dirk Groot, la baisse des déchets sauvages est en fait plus marquée. Les mesures de Groot montrent une baisse de 62 % entre les six premiers mois de 2022 et les six premiers mois de 2020.
Des organisations d’agriculteurs, des organisations environnementales, des villes et municipalités flamandes et un représentant du gouvernement néerlandais ont parlé des éléments qui constituent un système de consigne efficace.
La Commission de l’environnement du Parlement flamand a tenu des auditions mardi 18 et mercredi 19 octobre suite à la Proposition de résolution relative à la réduction des plastiques jetables et à l’introduction rapide d’une consigne sur les récipients à boisson, présentée par les députés Mieke Schauvliege (Groen), Steve Vandenberghe (Vooruit) et leurs collègues. Pieter Elsen y a représenté la voix de plus de 15 000 citoyens qui ont signé la pétition de Canal It Up.
L’Agence publique des déchets de Flandre OVAM a publié le rapport “Zwerfvuil en sluikstort 2021” le vendredi 14 octobre. Elle montre que l’industrie n’a pas réussi à atteindre la réduction de 20% en poids. Cet objectif avait été fixé dans le Plan de mise en œuvre des déchets ménagers et commerciaux assimilés 2016-2022, l’accord sur les emballages 2018 et l’accord de coalition du gouvernement flamand 2019-2024. L’accord de coalition stipule en outre que si les objectifs ne sont pas atteints, un système de consigne ou de récompense sera introduit.
Lors de l’audition, l’OVAM a expliqué davantage les chiffres et a souligné qu'”aucune diminution structurelle des déchets sauvages ne peut être observée“. L’OVAM a également analysé l’efficacité du système de recyclage belge actuel. En particulier pour les emballages en plastique, le taux de recyclage n’est pas aussi élevé que dans d’autres pays.
Depuis le début de son mandat, la ministre flamande de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) a averti le secteur à plusieurs reprises que l’Accord de coalition flamand 2019-2024 prévoit que la Flandre introduira une consigne sur les canettes et les bouteilles dans le cas où la réduction en poids de -20 % des déchets sauvages d’ici 2022 ne serait pas atteinte.
Lors des auditions, les experts ont parlé des chiffres des déchets sauvages et de ce que sont les éléments constitutifs d’un système de consigne efficace. Plus d’une fois, il a été fait référence à l’expérience pratique des pays qui ont déjà mis en place la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Il en est ressorti toute une série de facteurs de succès.
Le système doit être simple, facile et accessible, ont souligné les experts de l’OVAM, de Recycling Netwerk et de Canal It Up, entre autres. L’Association des villes et communes flamandes VVSG a également plaidé avec force pour que la collecte soit à charge du secteur de la distribution et mise en place dans les supermarchés et autres points de vente – et qu’il n’est pas question d’utiliser l’espace public à cette fin. En outre, l’OVAM a proposé un cadre légal minimum avec l’obligation pour les moyennes et grandes surfaces – de plus de 400 m2 de surface de vente nette – vendant des boissons de servir de point de collecte.
Le montant de la consigne doit être suffisamment élevé pour constituer une incitation financière, ont souligné les intervenants de Recycling Network Benelux, BondBeterLeefmilieu, Canal It Up, l’Association des villes et communes flamandes (VVSG) et OVAM.
Il est important de constater que le représentant du syndicat des agriculteurs Boerenbond a défendu l’introduction du système de consigne avec son homologue du syndicat Algemeen Boerensyndicaat. Après tout, les éleveurs et les producteurs de légumes doivent lutter contre la présence de tessons de canettes qui constituent aussi bien un problème lors de la récolte et qu’un risque pour la santé du bétail.
Une large majorité des députés flamands de la majorité et de l’opposition soutient l’introduction de la consigne.
La ministre Demir a déclaré le 14 octobre qu’elle mettait l’introduction de la consigne à l’ordre du jour du gouvernement flamand pour une décision avant la fin de cette année. Le CD&V, partenaire de la coalition, ainsi que les partis d’opposition Vooruit et Groen sont depuis longtemps partisans de la consigne. Demir se concerte également avec ses collègues wallons et bruxellois, Céline Tellier et Alain Maron (tous deux d’Ecolo) pour introduire la consigne dans toute la Belgique.
Au Parlement flamand, Fost Plus et la fédération professionnelle Comeos ont également pris la parole. Ils ont continué à s’opposer à l’introduction du système de consigne avec collecte des emballages vides de boissons dans les points de vente. Le directeur général de Fost Plus, Wim Geens, a proposé une “approche intégrale” et un système de scan par lequel les citoyens devraient scanner chaque emballage avant de les jeter dans un sac bleu ou une poubelle publique (qu’ils devraient scanner également).
De nombreux experts et députés ont souligné qu’un tel système de scan n’existe actuellement nulle part dans le monde. La technologie nécessaire à cet effet doit encore faire l’objet de recherches et de développements. Simplement pour la recherche, l’industrie a déclaré précédemment qu’il lui faudrait jusqu’en 2025 pour y parvenir, sans garantie de développement ultérieur de la technologie nécessaire. En outre, les députés ont soulevé des questions sur les risques de fraude et de violation de la vie privée et ne sont pas certains que tous les utilisateurs ont les compétences numériques nécessaires pour utiliser un système de scan avec QR-codes.
Selon Nathalie De Greve, directrice du développement durable chez Comeos, un système de consigne avec reprise par les magasins est “extrêmement coûteux, injuste, antisocial et compromet également le succès du sac bleu”.
La ministre flamande de l’environnement, Zuhal Demir (N-VA), a répondu en disant qu’elle désapprouve l’attitude négative de la fédération du commerce Comeos à l’égard de la reprise en point de vente : “La technique du retardement, si transparente. Il est facile d’essayer de se soustraire à ses responsabilités en tant qu’industrie, mais cela ne passera pas”, a écrit le ministre Zuhal Demir sur Twitter.
Commission 18 Octobre 2022
Commission 19 Octobre 2022
En plus des mesures plus anciennes effectuées aux États-Unis (années 1970 et 1980) et au Danemark (2017), les résultats des mesures récentes aux Pays-Bas (2018 – 2022) montrent désormais également que l’introduction de la consigne réduit considérablement le nombre d’emballages de boissons dans les déchets sauvages.
Dans les années 1970 et 1980, les États américains de New York, de l’Iowa, du Maine, du Michigan, de l’Oregon et du Vermont ont mené ou commandé des études visant à déterminer l’impact de la consigne sur les déchets sauvages en comptabilisant le nombre de canettes et de bouteilles aux mêmes endroits avant et après l’introduction de la consigne. Une analyse fédérale réalisée par le Bureau de la Responsabilité Gouvernementale (GAO) des États-Unis a conclu que ces études ont été menées de manière indépendante et approfondie par les différents États et, qu’ensemble, elles permettent d’évaluer l’impact de la consigne sur les déchets sauvages. Les méthodologies des études ne sont pas tout à fait identiques, mais elles sont similaires. Ces études ont montré que l’introduction de la consigne sur les emballages de boissons a entraîné une réduction d’environ 70 à 84 % (en nombre) des emballages concernés dans les déchets sauvages. Cela a permis de réduire la quantité totale de déchets de 30 à 45 %. Le bureau d’étude CE Delft a utilisé ces résultats dans son étude Coûts et effets des consignes sur les petites bouteilles en plastique et canettes (2017) pour estimer les effets de la consigne sur la quantité de petites bouteilles en plastique et de canettes dans les déchets sauvages. CE Delft a également résumé les résultats des études américaines (voir le tableau ci-dessous). Tableau 15 – Réductions mesurées des déchets sauvages par l’introduction de la consigne

*Pour le Maine, Technum (2015) a rapporté une réduction plus faible de 56 %. Une réévaluation de l’origine de ce phénomène montre que la plupart des déchets d’emballages proviennent également d’emballages non consignés. Pour tous les récipients de boissons avec consigne, 69 à 77% étaient des rapports mesurés (USA, 1980). Pour le Michigan, 78,4% pour les canettes et 51,1% pour les bouteilles ont été rapportés par Technum (2015). Une mesure plus détaillée indique 87,4% pour les contenants de bière et de boissons gazeuses et 79,6% pour tous les contenants consignés (USA, 1980). Le Michigan lui-même a rapporté une réduction de 84% (Michigan, 1979).
Des données ont également été collectées au Danemark, montrant que la consigne réduit significativement la présence d’emballages consignés dans les déchets sauvages. CE Delft (2017) a conclu qu’au Danemark, la consigne a conduit à une réduction de 70 à 90% des canettes consignées dans les déchets sauvages. Il se réfère à trois sources danoises différentes qui donnent un aperçu de la proportion de canettes dans les déchets sauvages avec et sans consigne. Ces pourcentages de réduction sont conformes aux résultats américains des années 1970 et 1980.
| Explication de la présence de canettes sans consigne au Danemark Malgré le fait qu’il existe une consigne sur les canettes au Danemark depuis 2002, il y avait (principalement) des canettes sans consigne dans les déchets sauvages. Il s’agissait en majorité de canettes provenant des magasins de l’autre côté de la frontière – en Allemagne – qui vendent des emballages avec des étiquettes spéciales qui ne sont pas assorties d’une consigne allemande (ou danoise). Selon les données, le rapport entre les canettes avec et sans consigne au Danemark est donc de 50/50. Le nombre d’emballages allemands mis sur le marché (sans consigne) est d’environ 600 à 700 millions, selon un communiqué de presse du cabinet juridique. Ce nombre est similaire au nombre de canettes consignées communiqué par Dansk Retursystem (650 millions d’unités). |
Au Danemark, un grand groupe de volontaires collecte et compte chaque année les canettes parmi les déchets sauvages. Ce faisant, ils font la distinction entre les canettes avec et sans consigne. CE Delft (2017) se réfère au comptage le plus récent de 2016. Cette année-là, plus de 100 000 canettes ont été collectées, dont 23% de canettes consignées et 77% de canettes non consignées. CE Delft (2017) a calculé que pour les mêmes volumes de consommation de canettes danoises et allemandes, la probabilité que les canettes danoises finissent dans les déchets sauvages est 3,3 fois plus faible que pour les canettes allemandes sans consigne (77%/23%). Cela correspondrait à une réduction d’environ 70%.
| Calcul : en supposant que 77 canettes sont initialement jetées dans les déchets sauvages, après l’introduction de la consigne, il n’en étaient plus jetées que 23 canettes. Cela représente une réduction de 54 canettes. Soit un taux de réduction d’environ 70% (54/77 = 70%). |
Dansk Retursystem, opérateur du système de consigne danois, a partagé à CE Delft qu’en 2014, 80% du nombre de canettes dans les déchets sauvages étaient des canettes sans consigne. CE Delft a conclu que selon ces données, une canette sans consigne a 4 fois plus de chances de finir dans les déchets qu’une canette avec consigne. Cela correspond à une réduction de 75%.
| Calcul : si au départ 80 canettes finissaient dans les déchets sauvages, avec ce ratio après introduction il y en aurait seulement 20. Il s’agit d’une réduction de 60 (80 – 20) ou de 75 % (60/80 égale 75 %). |
CE Delft a reçu des données de mesure pour les années 2008-2018 de Danmarks Naturfrednings-forening, l’organisation qui supervise les recensements annuels. Pendant cette période un total de 1 520 781 canettes ont été collectées, dont 162 995 avec une consigne (et donc 1 357 786 sans consigne). Cela signifie qu’environ 90 % des canettes dans les déchets sauvages sont des canettes sans consigne. D’après ces données, les canettes ont 9 fois plus de chances de devenir des déchets sauvages lorsqu’elles ne sont pas consignées. CE Delft a calculé que cela correspond à une réduction d’environ 90 %.
| Calcul : Avant introduction, 90 canettes finissaient dans les déchets sauvages. Après introduction, ce nombre tombe à 10. La réduction est de 80/90 soit (arrondi) 90%. |
Le cabinet d’études CE Delft a examiné l’effet des consignes sur la quantité de bouteilles et de canettes dans les déchets sauvages dans l’étude Coûts et effets des consignes sur les petites bouteilles et canettes (2017). Pour cela, ils ont examiné les données répertoriées des États-Unis et du Danemark. Sur la base de ces chiffres (et des calculs basés sur la propre enquête de CE Delft en 2001), CE Delft s’attend à ce que “la consigne réduise de 70 à 90% le nombre de canettes et de bouteilles dans les déchets sauvages”.
Le 10 mars 2018, Stientje van Veldhoven, alors secrétaire d’État, a annoncé qu’elle introduirait une consigne sur les petites bouteilles en plastique contenant de l’eau et des boissons gazeuses, à moins que l’industrie ne parvienne à (a) recycler 90 % des petites bouteilles en plastique et (b) réduire de 70 à 90 % la proportion de bouteilles en plastique dans les déchets sauvages d’ici l’automne 2020. La réduction de 70 à 90 % des déchets sauvages était basée sur les résultats attendus de la consigne du rapport de CE Delft (2017) et donc des mesures effectuées aux États-Unis et au Danemark. Compte tenu de l’accord de performance sur la réduction des déchets sauvages, un monitoring a été mis en place. Le Rijkswaterstaat rend compte tous les six mois du nombre de bouteilles en plastique dans les déchets. Ils ont commencé au premier semestre 2018. À partir de la deuxième mesure (sur le second semestre 2018), RWS a également compté le nombre de canettes dans les déchets sauvages et l’a inclus dans le rapport. Depuis le rapport au premier semestre de l’année 2019, RWS inclut également les mesures du Zwerfinator Dirk Groot dans son rapport. Rijkswaterstaat et Dirk Groot utilisent chacun leur propre méthodologie.
Lorsque le rapport du Rijkswaterstaat d’avril 2020 a montré que l’industrie ne parviendrait pas à réduire d’au moins 70 % la part des bouteilles en plastique dans les déchets sauvages d’ici à l’automne 2020 (le nombre de bouteilles en plastique dans l’environnement ayant augmenté de 7 %), la secrétaire d’État de l’époque, Stientje van Veldhoven, a avancé la décision, le 24 avril 2020, d’introduire une consigne sur les petites bouteilles en plastique contenant de l’eau et des boissons rafraîchissantes à partir du 1er juillet 2021. Recycling Netwerk Benelux a insisté à l’époque pour que le contrôle du nombre de petites bouteilles en plastique par le Rijkswaterstaat se poursuive après l’introduction de la consigne sur ces emballages de boisson. De cette façon, de nouveaux chiffres permettraient de mieux comprendre l’effet de la consigne sur le nombre d’emballages de boissons jetés dans la nature. Ce qui a été fait.
Les premiers résultats après l’introduction de la consigne au 1er juillet 2021 concernaient le suivi sur le second semestre de l’année 2021. Le 3 janvier 2022, le Zwerfinator Dirk Groot a communiqué que ses recherches montraient que la proportion de petites bouteilles en plastique dans les déchets sauvages avait diminué depuis l’introduction de la consigne. Au dernier trimestre de 2021, il a enregistré 70,2 % de bouteilles en plastique en moins par kilomètre que la moyenne des derniers trimestres des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Le rapport du Rijkswaterstaat pour le second semestre 2021 (daté du 15 février 2022) a été communiqué le 5 avril 2022. Ce rapport montre que le Rijkswaterstaat a compté 41 % de petites bouteilles en plastique en moins dans les déchets sauvages au second semestre 2021, comparé au second semestre 2020. A noter que la consigne a été introduite sur les petites bouteilles en plastique contenant des boissons gazeuses et de l’eau. Certaines autres catégories de petites bouteilles en plastique restent donc en dehors du système de consigne, par exemple les produits laitiers et les jus de fruits. Il est donc important de noter que, dans le cas des deux mesures ci-dessus, le taux de réduction porte sur l’ensemble des petites bouteilles en plastique. La réduction de 70,2 % mesurée par Groot concerne le quatrième trimestre et celle de 41 % mesurée par Rijkswaterstaat concerne les troisième et quatrième trimestres de 2021. La marge dans les résultats s’explique en partie par le fait qu’au troisième trimestre, de nombreuses bouteilles non consignées traînaient encore dans les déchets sauvages et que des (vieilles) bouteilles non consignées étaient également encore vendues. En effet, les producteurs ont le temps de vendre encore leur vieux stock sans consigne. Ce faisant, Groot nettoie également les récipients de boisson comptés dans les déchets sauvages pendant ses mesures, ce qui évite qu’ils soient comptés dans plusieurs mesures. Rijkswaterstaat ne fait que compter et laisse traîner les récipients de boissons. Cela permet aux “vieilles” bouteilles, toujours sans consigne, de revenir plusieurs fois en compte. Cela répartit donc quelque peu le pourcentage de réduction.
Le 12 septembre 2022, le Zwerfinator Dirk Groot a publié son rapport avec les résultats du suivi jusqu’au premier semestre de l’année 2022 inclus – soit un an après l’introduction de la consigne. Dans ce rapport, Groot calcule le pourcentage de réduction pour les bouteilles en plastique dans la catégorie sur laquelle la consigne est en place : les boissons gazeuses et les eaux. Ses mesures indiquent une diminution de 76 % de ces petites bouteilles en plastique – contenant de l’eau et des boissons non alcoolisées – dans les déchets sauvages. Ce pourcentage de Groot est déjà uniquement concentré sur les bouteilles d’eaux et de boissons gazeuses. Cependant, la mesure est encore “polluée” par des bouteilles sans consigne. Considérez, par exemple :
La consigne ne porte pas sur ces bouteilles, elles ne doivent donc pas être comptabilisées pour mesurer l’impact réel des consignes. Ce dernier rapport de suivi de Groot est d’autant plus précieux que, dans ses décomptes pour la catégorie des boissons non alcoolisées et de l’eau, il établit une distinction supplémentaire entre les bouteilles en plastique avec et sans consigne. Ses mesures montrent que le nombre de bouteilles en plastique pour les boissons gazeuses et l’eau dans l’environnement avec consigne est maintenant de 1 par km, alors que pour le même groupe de boissons sans consigne, il était auparavant de 6,9 par km. L’effet réel de la consigne aux Pays-Bas se traduit donc par une réduction de 85 % des petites bouteilles en plastique dans l’environnement. Le rapport du Rijkswaterstaat pour le premier semestre 2022 est toujours attendu. Il inclura à nouveau l’ensemble de données de Groot.
Il y a deux remarques importantes à faire sur les résultats du suivi pour le premier semestre 2022. Selon la législation néerlndaise sur la consigne, une consigne doit être prélevée sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau et des boissons non alcoolisées. Cela exempte effectivement d’autres boissons, comme les jus de fruits et les produits laitiers, de la législation sur les consignes. Le 24 janvier 2022, l’Inspection de l’environnement et des transports (ILT) a décidé que les bouteilles en plastique contenant du jus auquel de l’eau et du sucre ont été ajoutés sont également couvertes par le système de consigne, car ces boissons sont légalement classées comme des boissons non alcoolisées. Cette décision a été prise en réponse à une demande d’application de la loi émanant de Recycling Network, qui a constaté en novembre 2021 que, jusque-là, de nombreuses boissons de ce type (comme les nectars, les jus – de fruits – et les multivitaminés) se trouvaient dans les rayons sans consigne. L’industrie a eu trois mois pour corriger cette erreur. Ainsi, davantage de bouteilles ont été soumises à une consigne à partir d’avril 2022, le respect de la législation sur la consigne ayant été amélioré à partir de cette date. Cela signifie que la fraction des bouteilles qui finissent moins dans les déchets sauvages grâce aux consignes a augmenté. Le 2 février 2022, Statiegeld Nederland a ouvert le système de consigne aux bouteilles en plastique contenant 100 % de jus. Les boissons composées à 100 % de jus ne sont toujours pas soumises à la législation sur la consigne, mais depuis cette date, les producteurs de jus peuvent participer volontairement au système de consigne (si les bouteilles répondent aux conditions de recyclage énoncées par Statiegeld Nederland). Cette ouverture permet de d’appliquer une consigne sur un plus grand nombre de bouteilles en plastique. Albert Heijn a communiqué qu’il allait commencer à faire payer une consigne sur toutes les bouteilles de jus de fruits portant la marque Albert Heijn à partir du 12 mai 2022. On ne sait pas exactement combien de producteurs prélèvent aujourd’hui une consigne sur leurs boissons et, par conséquent, quelle est la proportion de jus sur lesquels il y a maintenant une consigne. Dans son dernier rapport, Groot indique qu’une diminution du nombre de bouteilles contenant du jus dans les détritus (-22%) peut être observée au premier semestre 2022, mais que cela se situe dans la fourchette des fluctuations des années précédentes.
À partir de la deuxième mesure (couvrant le second semestre 2018), Rijkswaterstaat a également inclus dans son suivi le nombre de canettes dans les déchets sauvages. La mesure la plus récente de Rijkswaterstaat sur le second semestre de 2021 montre une augmentation de 21% des canettes dans l’environnement. Cela contraste fortement avec la diminution de 41% des bouteilles observée dans le même rapport RWS. Une consigne sera également prélevée sur les canettes à partir du 31 décembre 2022. Le rapport de suivi du premier semestre 2023 donnera donc également un aperçu de l’effet des consignes sur la proportion de canettes dans les déchets sauvages.
Emission entière :
Les Belges connaissent déjà les machines qui prennent les bouteilles en verre, par exemple pour la bière, en échange d’une consigne. Mais il n’y a toujours pas de consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique.
Le nettoyage des déchets sauvages coûte chaque année 84 millions d’euros à la Wallonie. Au même moment, la contribution de l’industrie à Fost Plus n’est que de 5 millions par an.
L’enquête cherche à savoir pourquoi la consigne est bloquée depuis des années, alors que d’autres pays ont montré qu’elle est radicale contre les détritus. Pour le savoir, les journalistes se sont adressés à Carlo Di Antonio, ministre wallon de l’environnement en 2014, et qui souhaitait introduire la consigne. Il explique comment l’industrie (producteurs de boissons et supermarchés) résiste depuis des années. Fost Plus dit avoir investi des millions dans de nouveaux systèmes de tri pour le sac bleu élargi.
Les journalistes d’Investigation interviewent, entre autres, un éleveur de bovins qui a perdu une vache après qu’elle ait mangé des tessons d’une canette.Aux Pays-Bas, ils rencontrent le Zwerfinator Dirk Groot qui montre comment la consigne aux Pays-Bas a fait chuter le nombre de bouteilles en plastique dans la nature.
“Le vent est en train de tourner pour le secteur belge. La consigne n’a jamais été aussi proche”, écrit Quentin Ceuppens, journaliste de RTBF. Après avoir longtemps décliné, Fost Plus a accédé à sa demande d’interview. Le PDG de Fost Plus, Wim Geens, y a présenté une idée : “un système numérique où vous scannez la canette ou la bouteille à la maison avec votre smartphone”. Fost Plus souhaite ainsi éviter que les supermarchés aient à collecter les canettes et les bouteilles vides, pour que les bouteilles et canettes restent dans le nouveau sac bleu. Cependant, la collecte dans les supermarchés fonctionne bien dans tous les pays où il y a une consigne, comme c’est le cas en Belgique pour les bouteilles de bière. Le système proposé par Fost Plus quant à lui n’existe encore nulle part.
Extrait de l’entretien avec Wim Geens, PDG de Fost Plus
Diffusion complète : Mercredi 12 octobre 2022 20h15, #Investigation, La Une, RTBF
Disponible en direct sur https://t.co/z62vwDrywz
Ces objectifs aident les producteurs à réduire l’utilisation de matières premières pour leurs produits. La disponibilité des matières premières est actuellement soumise à une forte pression en raison de la guerre en Ukraine.
Lorsque la pandémie du COVID a frappé de plein fouet en 2020, de nombreux pays se sont retrouvés à l’arrêt. Cette pandémie a montré à quel point les Pays-Bas et le reste de l’Europe sont dépendants d’un approvisionnement de matières premières constant provenant d’autres pays. Le porte-conteneurs Ever Given, qui s’est retrouvé bloqué dans le canal de Suez en 2021, a perturbé l’approvisionnement en matières premières, matériaux et produits essentiels pendant des mois. Cela a encore souligné notre dépendance à l’égard des importations étrangères.
La guerre en Ukraine souligne notre dépendance pour ces matières premières. L’utilisation du gaz et du pétrole russes est au centre de l’attention en Europe depuis des mois.
L’utilisation des matières premières fait l’objet de discussions depuis bien plus longtemps, car leur extraction et leur transformation en matériaux et produits entraînent de nombreux problèmes environnementaux. Il en va de même pour l’élimination des matériaux et produits jetés. Quelques chiffres tirés du nouveau plan d’action pour l’économie circulaire de la Commission européenne l’illustrent :
Notre utilisation de matières premières est responsable de la moitié des gaz à effet de serre, qui sont à l’origine du changement climatique. Plus de 90% de la perte de biodiversité et du stress hydrique peuvent être attribués à l’extraction et au traitement des matières premières. L’utilisation des ressources mondiales devrait doubler au cours des 40 prochaines années. La production de déchets augmentera donc de plus de 70%.
De nombreux autres problèmes environnementaux sont également liés à notre utilisation des ressources, comme la soupe de plastique dans l’océan et la crise de l’azote. Réduire notre utilisation des ressources pour l’environnement était donc une priorité politique avant de devenir une urgence géopolitique. Elle était déjà au cœur du programme politique néerlandais “Netherlands Circular in 2050” de 2016, et du nouveau plan d’action européen 2020 pour l’économie circulaire.
L’utilisation de nos ressources est en grande partie liée à la production et à la consommation de produits. Les consommateurs ont un rôle à jouer par leur comportement d’achat, mais ils dépendent également de l’offre de produits. L’engagement des producteurs en particulier est donc crucial pour réduire notre utilisation des ressources.
Tant le gouvernement néerlandais que la Commission européenne souhaitent que les producteurs rendent leurs produits durables. Pour ce faire, les producteurs ont besoin de conseils et de certitudes. Les objectifs jouent un rôle important à cet égard. Ils fournissent des indications sur la manière dont les producteurs peuvent rendre leurs produits plus durables.
Les producteurs sont déjà responsables de leurs produits après qu’ils aient été jetés par les consommateurs. Les objectifs de recyclage obligent les producteurs à recycler au moins une partie de ces déchets.
Le durcissement des objectifs de recyclage garantit que de plus en plus de produits en fin de vie entrent dans le processus de recyclage (augmentation du recyclage). Mais les objectifs de recyclage ne garantissent pas que les matériaux recyclés issus du processus de recyclage soient réutilisés pour fabriquer les mêmes nouveaux produits (meilleur recyclage). Les matériaux recyclés (secondaires) sont généralement de qualité insuffisante pour cela. Des matières premières restent donc nécessaires à la production de nouvelles matières (primaires).
En effet, dans la pratique, bien que davantage de déchets soient recyclés, la quantité de nouveaux matériaux (primaires) et donc notre demande de matières premières ont continué à croître jusqu’au début de la pandémie. Aussi, les objectifs de recyclage ne suffisent pas à réduire de manière significative notre utilisation de matières premières.
Les matériaux recyclés issus du processus de recyclage doivent devenir d’une qualité suffisante pour remplacer les matériaux primaires dans de nouveaux produits similaires. L’Europe peut y parvenir en fixant des objectifs de “contenu recyclé”. Ces objectifs fixent des exigences minimales concernant la part de matériaux recyclés dans les nouveaux produits.
Outre les objectifs de recyclage (plus de recyclage) et de contenu recyclé (meilleur recyclage), des objectifs sont également nécessaires pour une plus grande réutilisation et une utilisation des produits inférieure (prévention). Dans une lettre commune adressée au début de l’année, les ministres de l’environnement de l’Autriche, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède ont donc demandé à la Commission européenne d’inclure de tels objectifs dans la directive européenne sur les emballages.
La directive sur les emballages est actuellement en cours de révision par la Commission européenne. La Commission européenne envisageait déjà d’inclure des objectifs de réemploi. Les cinq pays ont demandé à la Commission européenne d’ajouter des objectifs en matière de prévention (utilisation moindre de produits) et de contenu recyclé.
Outre la directive européenne sur les emballages, la Commission européenne réexamine également la directive-cadre européenne sur les déchets. Si la Commission européenne décide de fixer des objectifs distincts pour la prévention (moins d’utilisation de produits), la réutilisation et un recyclage plus important et de meilleure qualité, tous les États membres, ainsi que les Pays-Bas, seront obligés d’adopter ces objectifs.
À l’initiative de Recycling Netwerk et Het Groene Brein, un groupe d’universitaires néerlandais a mis au point un système permettant de fixer des objectifs circulaires pour des groupes de produits qui, parallèlement, réduisent l’utilisation de matières premières pour ces groupes de produits. Il s’agit d’objectifs circulaires pour la prévention (moins d’utilisation de produits), plus de réutilisation et un recyclage plus important et de meilleure qualité.
Le système comprend 12 critères auxquels ces objectifs circulaires doivent répondre, ainsi que des règles de calcul permettant de fixer des objectifs quantitatifs en matière de prévention (moins d’utilisation de produits), de réutilisation et de recyclage plus nombreux et de meilleure qualité pour un groupe de produits. Les critères sont fondés sur les documents de politique générale et la littérature.
Télécharger le rapport (anglais)
Pour montrer comment le système fonctionne, le groupe d’universitaires l’a appliqué à des emballages en verre. Le format des objectifs de circularité pour les emballages en verre pour une année cible donnée est le suivant :
L’exemple de l’emballage en verre montre que de multiples combinaisons de prévention, de réutilisation et d’un recyclage plus nombreux et de meilleure qualité permettent d’obtenir la même réduction de matières premières. Cela donne au gouvernement une marge de manœuvre pour travailler avec les producteurs et les parties prenantes afin de déterminer la combinaison d’objectifs circulaires la plus souhaitable à cet égard.
Pour l’exemple des emballages en verre, la réutilisation s’avère presque aussi efficace que la prévention. En effet, les emballages en verre réutilisables, aujourd’hui principalement des bouteilles de bière, peuvent être réutilisés jusqu’à 20 à 30 fois. Pour les autres emballages et produits, s’ils sont réutilisés, le taux de réutilisation est généralement beaucoup plus faible. La prévention est alors de loin plus efficace que la réutilisation.
En théorie un recyclage plus important et de meilleure qualité peut réduire complètement l’utilisation des matières premières, en pratique, il ne le peut pas. Par rapport aux emballages dans d’autres matières, le recyclage des emballages en verre obtient de bons résultats, mais il reste beaucoup à faire avant d’atteindre une réduction des matières premières d’au mieux 60%. Ces 60% seraient un maximum réaliste.
La prévention, mentionnée ci-dessus, signifie utiliser moins de produits en poids à chaque fois. Cela peut se faire en utilisant moins de produits en nombre, comme le covoiturage ou les smartphones dotés de plusieurs fonctions en une seule (téléphone, appareil photo, internet, etc.), mais aussi en concevant des produits plus économes en matériaux.
Les politiques européenne et néerlandaise utilisent généralement la prévention comme synonyme de réduction des déchets. Avec la réduction des déchets, la Commission européenne souhaite indirectement parvenir à une réduction des matières premières. On a déjà fait valoir ci-dessus que le recyclage, en tant que méthode de réduction des déchets, ne conduit pas nécessairement à une réduction des matières premières. C’est pourquoi un système d’objectifs circulaires est si précieuse. Ces mesures visent directement à réduire l’utilisation des ressources.
Les cinq universitaires soutiennent également que la prévention devrait désormais être systématiquement utilisée dans le sens d’une moindre utilisation des produits. La prévention (moins d’utilisation des produits), la réutilisation et le recyclage (plus important et de meilleure qualité) sont alors des stratégies pour réduire à la fois les déchets et les matières premières.
Le groupe d’universitaires est composé de José Potting de Recycling Netwerk Benelux, Ernst Worrell de l’université d’Utrecht, Arnold Tukker de l’université de Leiden, Antoine Heideveld de Het Groene Brein, Marko Hekkert de l’université d’Utrecht et Jacqueline Cramer de l’université d’Utrecht et ancienne ministre de l’environnement.
Het Groene Brein constitue un pont entre la science et la pratique dans le contexte de l’économie circulaire et autres transitions durables. Avec son réseau de 170 universitaires issus d’un large éventail de disciplines, nous prenons des mesures concrètes en faveur d’une économie durable et inclusive.
Recycling Netwerk Benelux (RNB) est une organisation environnementale indépendante qui travaille sur le thème des matières premières et de leur impact. Notre objectif est de minimiser les dommages environnementaux causés par l’extraction et la transformation des matières premières en matériaux et produits, ainsi que par le traitement des produits en fin de vie.
Télécharger Vers des objectifs circulaires (rapport complet en anglais, PDF)
Télécharger Vers des objectifs circulaires (résumé en néerlandais, PDF)
Dernière mise à jour : février 2024.
De plus en plus de gouvernements européens décident d’introduire la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. D’autres pays élargissent leur système de consigne existant. Le rythme s’accélère depuis l’adoption en 2019 de la directive européenne sur les plastiques à usage unique. Cette directive Single Use Plastic stipule que toutes les bouteilles en plastique devront contenir au moins 25 % de contenu recyclé d’ici 2025, et que les États membres doivent collecter séparément 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. Avec la consigne, les états s’attaquent aux déchets sauvages et à la pollution plastique. Dans cet article, nous examinons les différentes décisions des gouvernements et parlements concernant la consigne au sein de l’Union Européenne.
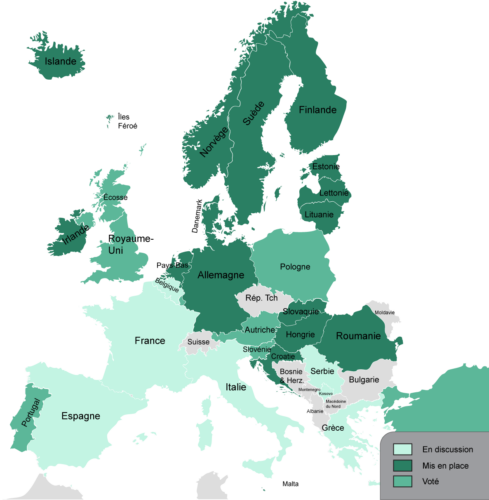
Visuel 1 – Pays européens dans lesquels la consigne est en place, votée ou en cours de discussion.
La ministre de l’environnement Leonore Gewessler a lancé le 7 septembre 2020 le plan en 3 parties du gouvernement autrichien pour mettre fin aux déchets plastiques. En Octobre 2021, la loi sur les emballages à usage unique a été adoptée. Elle prévoit un système de consigne sur les emballages de boissons à usage unique, les bouteilles en PET et canettes.
Le 8 septembre 2022, Léonore Gewessler a annoncé que le système sera opérationnel en 2025. Le montant de la consigne sera de 0,25€ sur tous les emballages entre 0,1 et 3 litres. Il n’y a qu’une exception, pour le lait, en raison de sa nature périssable.
Les emballages de boissons pourront être remis dans tous les points de vente ainsi que dans les gares et les centres de collecte de matériaux usagés. “L’objectif est de créer le meilleur et le plus efficace système de consigne en Europe”, a déclaré la ministre du climat. En outre, le gouvernement autrichien des conservateurs et des verts souhaite exiger que 25% des boissons soient vendues dans des bouteilles réutilisables à partir de 2023, puis 40% en 2025 et 55% en 2030. Un sondage d’opinion réalisé par Research Affairs en août 2020 montre que 81 % des Autrichiens sont favorables à une consigne sur les bouteilles en PET et 76 % à l’introduction d’une consigne sur les canettes.
Depuis le 1er Janvier 2024, la Hongrie a également introduit la consigne. Le système, opéré par l’opérateur système MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.). Le système couvre les boissons dans des emballages à usage unique en métal, bouteilles en verre et plastique, d’une contenance comprise entre 0,1 litre et 3 litres. (produits laitiers exclus). Les consommateurs paient une consigne de 50 forints hongrois (environ 0,13 €) lors de l’achat d’une boisson éligible, Tous points de vente de plus de 400 m2 doit accepter les emballages. De nombreux autres points participent également à a reprise de manière manuelle.
En Irlande, le gouvernement composé des conservateurs, des chrétiens-démocrates, des libéraux et des verts a annoncé en septembre 2020 qu’une consigne sera introduite au troisième trimestre de 2022. Malgré un retard de plus d’un an dans l’introduction du système, les canettes et bouteilles en plastique sont désormais également consignées et peuvent être rapportées en magasin depuis le 1er Février 2024. Le système est géré par l’opérateur système re-turn.
En Lettonie, le parlement a voté en octobre 2019 la loi sur les emballages qui introduit le système de consigne. Il a débuté le 1er février 2022. Le système de consigne comprend les emballages en verre, en plastique PET et en métal (canettes) remplis de boissons non alcoolisées, tous types de bière et d’autres boissons alcoolisées jusqu’à 6 %.
La Lituanie a promulgué en février 2016 la loi mettant en place la consigne pour les canettes et les bouteilles à usage unique. La consigne est la même pour tous les emballages et s’élève à 0,10 € par bouteille ou canette. Le système de consigne est géré par Užstato Sistemos Administratorius. Le taux de retour des bouteilles en plastique a depuis augmenté de façon spectaculaire : il était de 34% avant le système de consigne, de 74% fin 2016, de 92% fin 2017 et de 93% en 2018. La consigne a été introduite sous le gouvernement Butkevičius, composé de socialistes, de libéraux, de conservateurs et de démocrates chrétiens.
Le Parlement luxembourgeois a approuvé la loi sur la consigne le 5 mai 2022. Une consigne nationale unique sera d’application sur tous les “emballages de boissons destinées à la consommation humaine qui sont mis sur le marché luxembourgeois”. Le montant de la consigne variera entre 10 centimes et 1 euro, selon le type d’emballage. La loi prévoit déjà une obligation de reprise des déchets pour les responsables des emballages ou des déchets d’emballages des consommateurs ou de tout autre utilisateur final. Certains éléments seront précisés dans un règlement grand-ducal. Il s’agit principalement du montant de la consigne par type d’emballage de boisson, du calendrier détaillé du déploiement ainsi que des exigences relatives à l’organisation de la filière (par exemple, présence d’une administration centrale, organisation des producteurs).
À Malte, la réglementation sur la consigne des emballages de boissons est entrée en vigueur le 31 juillet 2020. Le système a vu le jour le 14 novembre 2022. Le montant de la consigne est de 0,10€ pour toutes les canettes en aluminium et en acier ainsi que les bouteilles en verre et en PET d’une capacité comprise entre 0,1 et 3 litres. Les produits laitiers, les jus de fruits, le vin et les alcools supérieurs à 5,0 % d’alcool par volume sont pour le moment exempts de ce système.
Aux Pays-Bas, le gouvernement Rutte III (libéraux des partis VVD et D66, chrétiens-démocrates du CDA et CU) a décidé en avril 2020 le lancement de la consigne sur les petites bouteilles en plastique dès le 1er juillet 2021. Le gouvernement néerlandais étend ainsi le système de consigne présent sur les grandes bouteilles en plastique à l’ensemble des bouteilles en plastique. Les producteurs de boissons Coca-Cola Pays-Bas et Spadel Pays-Bas ont montré leur soutien à l’expansion du système. Puisque la consigne garantit la qualité du plastique et un recyclage suffisant du PET, Coca-Cola a choisi les Pays-Bas comme second pays où elle mettra en vente des bouteilles en plastique 100% recyclé.
La consigne a rapidement donné des résultats en termes de propreté. Seulement six mois après l’introduction de la consigne sur les petites bouteilles, le ministère du Rijkswaterstaat comptait déjà une diminution de 41% des petites bouteilles dans la nature entre décembre 2021 et 2022.
En février 2021, le gouvernement hollandais a décidé d’introduire la consigne sur les canettes. Le système devait démarrer le 31 décembre 2022. Finalement, suite à une annonce unilatérale de l’industrie, l’expansion a eu lieu le 1er Avril 2023. L’impact sur les déchets sauvages est déjà prouvé, malgré les difficultés rencontrées.
Le gouvernement polonais a décidé le 2 juin 2022 qu’il y aurait une consigne sur les canettes et les bouteilles dès 2023. Absolument nécessaire dans la lutte contre les déchets sauvages, selon le ministre du climat et de l’environnement. Le système de consigne devra couvrir les bouteilles en verre jetables et réutilisables jusqu’à 1,5 litre, les bouteilles en PET jusqu’à 3 litres et les canettes en aluminium jusqu’à 1 litre. Une obligation de reprise sera présente pour les magasins d’une superficie supérieure à 100 m². Les points de vente plus petits pourront adhérer volontairement au système.
En octobre 2021, le gouvernement roumain a décidé d’introduire un système de consigne. Les consommateurs paieront une consigne de 0,50 RON (0,10 euro) à l’achat de boissons auprès des détaillants. Depuis le 30 novembre 2023, le système de consigne roumain couvre tous les emballages de boissons à usage unique en verre, plastique et métal, d’un volume compris entre 0,1 et 3 litres. Les emballages peuvent être rapportés dans tous point vendant des boissons.
En Slovaquie, le parlement a voté en septembre 2019 la loi instaurant un système de consigne sur les bouteilles PET et canettes dès 2022. Tous les magasins d’une superficie supérieure à 300 mètres carrés doivent reprendre les emballages vides. La consigne est d’un montant unique de 0,15 euros. Le système, administré par l’opérateur Slovensko zálohuje, est en place désormais et a démontré tout de suite des résultats impressionnants. En seulement un an, le taux de retour des emballages consignés est passé de 60 à 70%.
En Belgique, il existe une consigne sur certaines bouteilles en verre réutilisables, notamment pour la bière. Le débat sur l’introduction de la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique dure depuis plus d’une décennie. L’introduction de la consigne en Belgique relève de la compétence des régions de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. En 2018, l’industrie a eu une dernière chance de s’attaquer aux déchets sauvages de plus en plus nombreux par des actions de sensibilisation et la mise en place de sanctions. Cependant, la quantité de déchets sauvages en Flandre continue d’augmenter.
Depuis 2017, des centaines de municipalités, d’entreprises et d’organisations ont rejoint l’Alliance pour la Consigne, qui demande aux gouvernements régionaux d’introduire rapidement la consigne sur toutes les canettes et bouteilles en plastique. En 2019, les nouveaux gouvernements de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie ont inscrit la possible introduction d’une consigne dans leurs accords de coalition. Depuis 2021, plus de 100 communes wallonnes ont rejoint les 200 communes flamandes dans l’Alliance pour la consigne. Les partis d’opposition en Flandre (Vooruit) et en Wallonie (Les Engagés) ont mis des propositions sur la table de leurs parlements respectifs.
La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) a lancé en 2022 une étude sur la mise en place d’une consigne. À l’été 2022, la municipalité de Bredene a mené avec succès un projet pilote de consigne. Le 6 septembre 2022, la ministre flamande de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) a déclaré que la consigne est inévitable et que le gouvernement flamand prendra une décision en 2022 sur la base des derniers chiffres concernant les déchets sauvages.
Le nouvel agrément 2024-2028 de l’Éco-organisme responsable de la gestion des déchets ménagers (Fost Plus) prévoit l’introduction d’un système de consigne pour l’ensemble des canettes et bouteilles, sous couvert d’un accord entre les trois régions (article 2).
En Espagne, une large majorité a voté en faveur de la loi introduisant la consigne sur les emballages. La loi est maintenant sur la table du Sénat.
En France, la ministre Brune Poirson (du parti libéral En Marche) a déclaré le 10 juillet 2019 que le gouvernement français souhaite introduire la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes. Elle a reçu le soutien de supermarchés et de producteurs de boissons français, parmi lesquels des multinationales également actives en Belgique et aux Pays-Bas. La pression des maires conservateurs au Sénat français a reporté le projet à 2023. La mise en place d’une consigne pour les emballages de boisson réutilisables a été annoncée en juillet 2023, un projet de décret est actuellement discuté au Parlement. Parallèlement, la consigne pour le recyclage a été repoussée par le précédent ministre de l’Environnement Christophe Béchu en septembre 2023.
En mai 2021, le groupe de recherche Eunomia et l’Association des fabricants grecs d’emballages et de matériaux ont appelé le gouvernement grec à introduire un système de consigne dans le pays. La Grèce s’est engagée à introduire un système de consigne national à partir de juillet 2023, dans le cadre de la nouvelle législation nationale en matière de déchets, recyclage et économie circulaire.
Le groupe d’organisations non gouvernementales comprenant l’Association nationale des Comuni Virtuosi, Greenpeace Italia, Oxfam, WWF Italia et Zero Waste Italy a uni ses forces pour soutenir l’introduction d’un système national obligatoire de consigne pour les emballages de boissons en Italie. La campagne, intitulée “Buon Rendere – molto più di un vuoto“, est la première initiative nationale en faveur d’un système de consigne en Italie. Ils ont lancé un appel commun en novembre 2021 au gouvernement Draghi et à Roberto Cingolani, ministre italien de la transition écologique, pour accélérer l’introduction d’un système de consigne efficace dans le pays.
En mars 2020, un projet pilote pour un système de consigne à l’échelle nationale a été lancé au Portugal avec le soutien et l’appui de l’industrie alimentaire et des producteurs de boissons portugais. Le gouvernement a mis en place le décret-loi prévoyant l’introduction d’un système de consigne pour 2022. Cependant aucune décision n’a pour le moment été prise quant aux modalités pratiques de cette mise en place. Une pétition a été lancée par la Marine Environment Research Association pour demander au gouvernement d’introduire rapidement et de manière efficace ce système de consigne.
En mars 2018, le gouvernement britannique de Theresa May (Conservateurs) a annoncé un système de consigne sur les emballages de boissons. La série Blue Planet II avait dénoncé la menace de la pollution plastique des océans. En juillet 2019, le gouvernement britannique a déclaré qu’il visait 2023 pour disposer d’un système de consigne entièrement opérationnel. 84% des Britanniques sont en faveur de la consigne sur l’ensemble des emballages de boissons, démontre un sondage d’opinion réalisé par Populus en juin 2020.
En mai 2019, le gouvernement écossais, dirigé par Nicola Sturgeon du Parti National Écossais, a annoncé le projet d’instaurer la consigne sur les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre et les canettes. Le Parlement écossais a voté le système de consigne en mai 2020. L’Écosse sera ainsi la première région du Royaume-Uni à disposer de la consigne dès le 16 août 2023. Le système couvre toutes les boissons vendues en plastique PET, en métal et en verre. Il y aura une consigne unique de 20 pence (0,23 euro) pour tous les formats.
En Janvier 2023, les détails de l’introduction de la consigne au Royaume-Uni, au Pays de Galle et en Irlande du Nord ont été dévoilés. Les systèmes dans chaque région devraient voir le jour au 1er Octobre 2025. L’intégralité des bouteilles PET ainsi que les canettes en aluminium et acier seront incluses dans le système (entre 50mL et 3L). Les bouteilles en verre ne seront incluses que dans le système gallois. Les points de vente seront tenus de reprendre les emballages mis sur le marché (obligation de reprise).
En 2019, le directeur de l’Agence serbe de protection de l’environnement (SEPA), Filip Radović, a annoncé que l’introduction d’un système de consigne en Serbie pour réglementer le retour et l’élimination des déchets d’emballages pourrait être discutée en 2019. Bien que le sujet de la consigne soit sur la table depuis de nombreuses années, aucune décision n’a été prise à ce jour.
Le ministre slovène de l’environnement Andrej Vizjak est favorable à la proposition de mettre en place le système de retour des bouteilles en Slovénie, proposée par l’ONG environnementale Eko Krog fin 2021. L’association des entreprises de boissons soutient cette proposition car le système garantira une meilleure collecte séparée des bouteilles de boissons, tant celles qui peuvent être réutilisées que celles destinées au recyclage.
En Allemagne, le système de consigne est en place depuis 2003, soit depuis 18 ans. Il existe une consigne sur les emballages de boissons en plastique, en aluminium et en verre. Le montant de la consigne est de 0,25€ pour tous les emballages depuis 2016. La consigne est plus élevée pour les emballages jetables que pour les emballages réutilisables, tels que les bouteilles en verre. 97 à 99% des bouteilles jetables sont collectées. Le taux de retour des canettes est d’environ 99%. En janvier 2021, le gouvernement allemand d’Angela Merkel (CDU – SPD – CSU) a approuvé une nouvelle loi sur les emballages (Verpackungsgesetz). La consigne sur les emballages de jus et boissons alcoolisées est en place depuis Janvier 2022, et a été étendue aux produits laitiers en 2024. L’Allemagne a mis en place une consigne (Pfand) sur les bouteilles en plastique et les canettes depuis longtemps, en 2003. Mais les jus, le vin et le lait en étaient exemptés. La nouvelle loi sur les emballages ne s’intéresse donc qu’à l’ajout de ces emballages dans le système et non à la boisson qu’ils contiennent.
En Croatie, une consigne d’un montant de 0,5 kuna croate est prélevée sur les emballages non réutilisables d’un volume minimum de 200 ml depuis 2006. Les détaillants de plus de 200 m² sont obligés de reprendre les emballages consignés. Le système est géré par le gouvernement et l’objectif de collecte est de 95%. Depuis 2015, la consigne a assuré la réduction de 90% des emballages non réutilisables sur le marché croate.
Le premier système de consigne mondial a été introduit Danemark en 1922. En 1991 et 1993, la consigne a été étendue aux bouteilles en plastique. L’opérateur du système de consigne est Dansk Retursystem, une organisation privée à but non lucratif. En 2019, le système a atteint un taux de retour global de 92 %.
En Estonie, un système national de consigne et de recyclage des emballages à usage unique et des emballages réutilisables est en place depuis 2005. Le montant de la consigne est de 0,10 € sur la plupart des emballages de boissons en métal, en plastique et en verre. Le système est géré par Eesti Pandipakend, une organisation de producteurs représentant l’Association des brasseurs estoniens, l’Association des producteurs de boissons rafraîchissantes, l’Association des importateurs de boissons rafraîchissantes et de bière et l’Association des détaillants estoniens.
En Finlande, le système de consigne a été introduit pour la première fois en 1952 – au même moment que les Jeux olympiques d’été ont amené Coca-Cola dans le pays – sur les bouteilles en verre. Dans les années 1980, certaines bouteilles en plastique réutilisables et durables ont été incluses dans le système de consigne. La consigne a été introduite sur les canettes en aluminium en 1996, sur les bouteilles en PET en 2008 et sur les bouteilles en verre recyclé en 2012. Le système est géré par Suomen palautuspakkaus Oy (abrégé en Palpa), un consortium privé d’importateurs et de fabricants de boissons.
L’Islande dispose depuis 1989 d’un système de consigne national pour les emballages en plastique, en aluminium et en verre.
En Norvège, une loi introduisant la consigne a été adoptée en 1999. En 2018, le montant de la consigne a augmenté, passant à 2 NOK (petites bouteilles et canettes) et 3 NOK (grandes bouteilles). Infinitum AS (anciennement Norsk Resirk) est responsable de la mise en œuvre du programme national de recyclage des bouteilles en plastique à usage unique et des canettes. Cette organisation à but non lucratif a été fondée en 1999 et est détenue par des entreprises et des producteurs de boissons et du commerce alimentaire.
Le système norvégien fonctionne de telle manière que la “taxe environnementale” diminue à mesure que le taux de retour augmente. Cela signifie que, par exemple, avec un taux de retour de 90% pour les canettes, la taxe environnementale est réduite de 90%. Elle est nulle pour un taux de retour de 95%.
En Suède, les canettes en aluminium sont consignées depuis 1984 et les bouteilles en PET depuis 1994. Pantamera est responsable du système de consigne sur les canettes en aluminium et les bouteilles en PET.
En résumé, on peut parler d’une véritable course vers la consigne en Europe. Le débat sur la pollution plastique a lieu partout. Dans les États membres de l’Union européenne, on travaille d’arrache-pied à l’élaboration d’une législation visant à remédier la pollution plastique et les déchets sauvages. Le rythme diffère d’un pays à l’autre, mais la direction est la même.
La popularité de la consigne est également en hausse aux frontières de l’Union européenne. En janvier 2019, la Turquie a également décidé qu’il y aurait une consigne sur tous les emballages de boissons sous quatre ans. Avec 80 millions d’habitants, la Turquie sera le deuxième plus grand pays à disposer de la consigne au monde après l’Allemagne.
Dans le cadre de la révision du Réglement Européen sur les Emballages et Déchets d’emballages (PPWR) l’introduction obligatoire d’une consigne à l’horizon 2029 est discutée, assortie de caractéristiques essentielles. Cette obligation serait applicable à tous pays n’atteignant pas un certain taux de retour. La version finale de la décision est toujours attendue (info mars 2024).
La consigne sera de 0,25 euros pour tous les emballages entre 0,1 et trois litres. Il n’y a qu’une exception, pour le lait, en raison de sa nature périssable.
Les emballages de boissons pourront être remis dans tous les points de vente, mais également dans les gares et les centres de collecte de matériaux usagés. “L’objectif est de créer le meilleur et le plus efficace système de consigne en Europe”, a déclaré la ministre du climat.
Leonore Gewessler (Verts) a fait cette annonce lors d’une conférence de presse aux côtés du directeur des affaires publiques de Coca-Cola Autriche, Philipp Bodzenta, qui déclarait “c’est toujours une épine dans notre pied lorsque nos emballages se retrouvent dans l’environnement sans aucune valeur. Nous avons également constaté que dans les pays dotés d’un système de consigne, le taux de collecte des bouteilles et des canettes est plus élevé. C’est pourquoi nous avons besoin de ce système. Nous sommes sur la bonne voie à cet égard”, souligne M. Bodzenta.
Sources:
DiePresse, 25 Cent Pfand pro Flasche und Dose ab 2025 in Österreich
Puls 24, Pfandsystem Österreich: Künftig 25 Cent Pfand pro Flasche und Dose
Heute, 25 Cent extra für Plastikflaschen und Dosen fix
La consigne sur les bouteilles et les canettes est une mesure efficace contre les déchets sauvages. Le projet pilote s’est déroulé pendant un mois entier, du 15 juillet au 15 août 2022. À Bredene, le Twins Club et les bars de plage ont vendu leurs bouteilles et canettes en plastique avec une consigne supplémentaire de 0,20 €, clairement visible grâce à un autocollant placé sur celles-ci. Les consommateurs pouvaient ensuite rapporter manuellement l’emballage et récupérer leur consigne dans chacun des trois lieux, qui mettaient ensuite l’emballage vide dans une boîte spécifique. Simple et efficace.
Les résultats sont clairs. Plus de 6 000 emballages munis de cet autocollant “consigne” ont été vendus. À la fin du projet pilote, 77,20 % des canettes et des bouteilles en plastique munies d’un autocollant ont été retournées. Les résultats ont dépassé les attentes de la municipalité, qui tablait sur un taux de retour de 50 à 70 %.
Plus important encore, aucun emballage consigné n’a été trouvé sur la plage au cours de cette période. En effet, Proper StrandLopers a organisé deux campagnes de nettoyage pour suivre l’évolution des déchets sur la plage pendant le projet. Aucun emballage muni d’un autocollant n’a été trouvé, ce qui montre clairement que la consigne réduit considérablement la quantité d’emballages parmi les déchets.
Ce résultat est conforme à l’effet prouvé de la consigne sur les déchets dans d’autres pays. Aux Pays-Bas, le récent suivi de Dirk de Groot indique une diminution de 80 % de la quantité de petites bouteilles en plastique dans les déchets, un an après l’introduction de la consigne sur les petites bouteilles en plastique. Le projet pilote de Bredene a également confirmé cet impact en Belgique.
Comme l’a souligné l’un des commerçants du bar de plage Blauwe Brug sur la chaîne publique flamande VRT, aucun consommateur ne s’est plaint de la présence d’une consigne sur les boissons. Cela montre une fois de plus que le système de consigne est largement accepté par les consommateurs. Selon plusieurs sondages (Testachats, GfK), les consommateurs de toute la Belgique sont favorables à l’introduction d’une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes afin de réduire les déchets sauvages. Ce projet pilote montre qu’ils acceptent non seulement le concept d’une consigne, mais qu’ils y participent aussi activement.
Le problème des déchets sauvages en Belgique devient pressant ces dernières années. En Flandre, le gouvernement a demandé à l’industrie de réduire les déchets sauvages de 20 % en 2022, par rapport à 2015. Cette diminution est en lien avec l’impact le plus faible attendu pour un système de consigne, selon l’analyse d’impact réalisée par l’agence officielle flamande OVAM en 2015. Le dernier suivi en 2019 a montré une augmentation d’environ 14 %. Alors que le secteur est toujours réticent à l’introduction d’une consigne, l’intérêt pour ce système augmente parmi les citoyens et les municipalités. 70,7 % des municipalités flamandes ont rejoint l’Alliance pour la Consigne, une alliance qui demande aux gouvernements régionaux de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d’introduire la consignes sur les canettes et les bouteilles en plastique.
Au vu des résultats clairs et du large soutien apporté au projet pilote, il apparaît certain que la consigne est le moyen le plus efficace de réduire les déchets sauvages en Belgique. Comme le déclare Steve Vandenberghe, maire de Bredene, “l’introduction d’une consigne est une solution, et peut-être la seule, pour réduire les déchets sauvages“. Ce projet pilote montre qu’en Belgique aussi, un système de consigne aura un impact certain et clairement positif sur les déchets sauvages.
L’année dernière, le 1er juillet, nous avons célébré l’introduction des consignes avec l’Alliance pour la Consigne et la secrétaire d’État à l’I&W de l’époque, Stientje van Veldhoven, sur la plage de Scheveningen (photo). La consigne sur les bouteilles en plastique a été très bien accueillie par l’ensemble de la société.
Après seulement six mois, le Rijkswaterstaat a observé une forte baisse du nombre de bouteilles dans la nature. La consigne fonctionne donc. Toutefois, la secrétaire d’État à l’infrastructure et à la gestion de l’eau, Vivianne Heijnen, doit renforcer la législation afin d’exploiter pleinement le potentiel des consignes. Et ne pas attendre une évaluation en 2024 pour le faire.
La baisse du nombre de bouteilles en plastique dans les déchets est prometteuse. Les mesures effectuées par le Rijkswaterstaat et le Zwerfinator Dirk Groot montrent que le nombre de bouteilles en plastique dans la nature a déjà diminué de 41 % à 70 % six mois après l’introduction de la consigne. La consigne donne donc des résultats rapides. Elle est bien plus efficace que tous les plans alternatifs des milieux d’affaires au cours des dernières décennies. Alors que les entreprises promettaient des résultats depuis des décennies, la consigne est aujourd’hui à la hauteur. Bientôt, le Rijkswaterstaat proposera de nouvelles mesures des déchets après 12 mois.
Sur la base de mesures des déchets à l’étranger, CE Delft a conclu en 2017 qu’avec la consigne, le nombre de bouteilles dans les déchets néerlandais devrait diminuer de 70 à 90 %. Mais cela dépend de l’intelligence avec laquelle le système de consigne est mis en place. Les systèmes de consigne qui réussissent ont des caractéristiques communes qui sont inscrites dans la législation : un montant de consigne suffisamment élevé, un réseau finement maillé de points de vente où l’on peut récupérer la consigne, et une conception claire et sans exception qui est donc facilement compréhensible par les consommateurs.
Dans le décret sur la consigne de 2020, le gouvernement a inclus trop peu de règles et de cadres qui auraient garanti une mise en place efficace du système de consigne. C’est un exemple de législation environnementale qui laisse trop de place à la discrétion des entreprises. Pour exploiter pleinement le potentiel de la consigne et atteindre l’objectif européen de 90 % de collecte sélective pour toutes les bouteilles en plastique, les responsables politiques doivent prendre les devants et élaborer une meilleure législation.
Il existe encore toute une série de points de vente qui vendent des bouteilles en plastique qui sont consignées, mais qui ne restituent pas la consigne aux consommateurs. Il s’agit par exemple des cinémas Pathé, de la chaîne de fast food McDonalds, des magasins AH-To-Go, Hema, Kruidvat et Action, de La Place et de certains musées, théâtres, universités et stations-service.
Cela signifie qu’il y a moins de points de collecte aux Pays-Bas que si une obligation légale d’acceptation avait été établie pour les points de vente. Il est donc plus difficile pour les consommateurs de récupérer leur consigne. Cela nuit à l’efficacité du système de consigne. Nous demandons donc au secrétaire d’État d’inscrire dans la législation un droit à la consigne. De sorte que la consigne soit récupérée à chaque point de vente.
Dans les médias
Trouw, Un an de consignes sur les petites bouteilles : moins de bouteilles au bord des routes et dans les buissons, 1er juillet 2022
1Limburg, Moins de déchets grâce à l’introduction de la consigne sur les petites bouteilles, 1er juillet 2022
NOS, Après une année de consigne sur les bouteilles, 1er juillet 2022
Selon Statiegeld Nederland, au cours des six premiers mois suivant l’introduction de la consigne, quelque 70 % des bouteilles en plastique consignées ont été rapportées. Ce pourcentage inclut les grandes bouteilles, dont plus de 90 % sont collectées depuis des années. Les petites bouteilles en plastique sont donc encore loin derrière. Les Pays-Bas devront collecter plus de 90 % des bouteilles consignées pour se conformer à la directive européenne. Cette directive exige que 90 % de toutes les bouteilles de boisson en plastique, y compris celles qui ne sont pas consignées, soient collectées séparément.
Ce durcissement doit également inclure l’augmentation du montant minimum de la consigne et l’introduction de la consigne sur les briques à boisson et sur toutes les bouteilles en plastique, sans exception basée sur le contenu. À l’heure actuelle, la consigne n’est pas encore obligatoire sur les bouteilles de jus de fruits et de produits laitiers.
Le cabinet précédent, après des années de débat politique, a finalement opté pour l’environnement en introduisant une consigne sur les bouteilles en plastique. Il est maintenant important que le cabinet actuel veille à ce que les résultats escomptés soient atteints. Nous demandons au secrétaire d’État de renforcer la législation dès maintenant. Et de ne pas attendre l’évaluation du système de consigne prévue en 2024.
Après un an de consignes sur les bouteilles en plastique, il y en a déjà bien moins qui finissent dans la nature. En revanche, il y a toujours un grand nombre de canettes – qui ne sont pas consignées – dans la nature. Nous attendons donc avec impatience le début de la consigne sur les canettes le 31 décembre de cette année. L’industrie a indiqué que les délais étaient trop courts. Elle a annoncé unilatéralement qu’elle dépasserait la date légale d’introduction. Dans la plupart des pays européens, les entreprises disposent d’une période de mise en œuvre d’un an. Les entreprises néerlandaises ont eu 22 mois pour mettre en place la consigne sur les canettes. La secrétaire d’État Vivianne Heijnen a déclaré à juste titre à la Chambre des représentants que la date d’introduction était fixée au 31 décembre 2022 et que les entreprises qui ne respecteraient pas ce délai risquaient de se voir imposer une injonction sous astreinte.
Source: LeSoir.be “Instaurer une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique: une piste sérieuse en Wallonie”
Elle y parle aussi de l’échéancier et du contenu de cette étude. Nous présentons ci-dessous notre analyse du plan proposé et fournissons certaines suggestions afin que cette étude soit réalisée rapidement et de manière ciblée.
Avant tout, nous considérons que le lancement de l’appel des marchés publiques pour mandater un bureau d’étude pour cette étude est un premier pas dans la bonne direction. Passer du mythe à la réalité en mettant en place un système de consigne sur les canettes et les petites bouteilles en plastique en Belgique est une avancée claire dans la direction d’une réduction drastique des déchets sauvages le long des routes belges, dans les villes et dans la nature.
Le gouvernement wallon assure dans son accord de coalition “Déclaration de Politique – Wallonie – 2019-2024”, qu’il se portera garant de “la mise en œuvre progressive, à l’échelle de la Belgique, d’un système de consigne ou de prime de retour pour les canettes et les bouteilles PET, qui soit viable économiquement, efficace et qui permette d’obtenir des gains environnementaux et de propreté publique” avant la fin de la législature en 2024.
L’accord de coalition stipule donc essentiellement que la Wallonie introduira soit un système de “prime de retour“, soit un système de consigne. Ces systèmes sont très différents.
La prime de retour a été testée en Wallonie de septembre 2018 à juillet 2021 par Be WaPP, une ASBL créée par Fost Plus, et les fédérations de l’industrie et du commerce Fevia et Comeos. Sur base de l’évaluation du projet “prime de retour“, les membres de la Commission wallonne de l’environnement et la ministre ont unanimement conclu, le 19 octobre 2021, que la prime de retour n’est pas un système approprié pour rendre l’environnement wallon propre d’une manière économiquement viable. L’évaluation a montré le manque d’efficacité de ce système de prime de retour pour améliorer la propreté publique ainsi que le manque d’implication des citoyens, cela en plus d’être un système trop coûteux, comme nous l’avons expliqué dans un article précédent. Des articles de presse ont conclu que l’option de la prime de retour était “morte et enterrée” (L’Avenir, Canettes : prime de retour enterrée, vive la consigne, 19 octobre 2021).
Suivant l’accord de coalition, le gouvernement prend maintenant des mesures pour introduire le système de consigne. Afin de le faire dans le cadre de son mandat et de respecter l’accord de coalition, l’étude de faisabilité doit être ciblée et achevée en 6 mois.
Nous estimons que la réalisation d’une étude visant à renforcer le niveau de connaissances pour informer la décision d’instaurer un système de consigne et sa portée est une étape nécessaire. Toutefois, sa réalisation ne doit pas entraîner de retards inutiles dans le processus de décision politique, afin que le système puisse être mis en œuvre au cours du mandat du gouvernement actuel.
L’échéance prévue pour la présentation du rapport final de l’étude – juin 2023 – rend la mise en œuvre pratique d’un système de consigne en Wallonie (sans parler de l’ensemble de la Belgique) impossible avant la fin du mandat. Outre le temps de l’étude, il faut également prévoir un délai pour les procédures législatives entre la décision du gouvernement et la publication du décret, et pour que le secteur prévoit la logistique.
Le cadre juridique peut déjà être rédigé, sur la base des législations d’autres pays, et il est possible de gagner du temps en commençant les préparatifs juridiques parallèlement à l’étude de faisabilité. De plus, l’expérience montre qu’une étude de faisabilité peut être réalisée en 6 mois environ, comme ce fut le cas de l’étude d’impact de l’OVAM, publiée en juin 2015.
Premièrement, l’emploi d’un bureau d’étude compétent et indépendant ayant une expérience considérable dans la réalisation d’études sur la consigne garantira une étude réalisée dans un délai plus court.
Deuxièmement, il est utile de s’inspirer d’études antérieures réalisées dans différents pays. Elles peuvent servir de trame pour l’étude de faisabilité. Les études coûts-bénéfices de l’OVAM (2015) et de CE Delft (2017), toutes deux commandées par un gouvernement, avaient des objectifs similaires d’objectivation des impacts de l’introduction, respectivement en Flandre et aux Pays-Bas, d’une consigne.
Enfin, pour éviter tout retard inutile, il est important que l’étude se concentre uniquement sur le sujet nécessaire pour objectiver la situation et définir le modèle du système de consigne, comme le suggère Mme Tellier dans son interview à Le Soir. Le recours à un bureau expérimenté et l’apprentissage à partir d’études antérieures permettront de s’assurer qu’aucune dimension nécessaire n’est oubliée, mais aussi d’éviter que l’étude ne devienne trop vaste.
Pour réellement informer la décision concernant la mise en place d’un système de consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique en Wallonie et en Belgique, l’étude devrait se concentrer uniquement sur les éléments pertinents pour objectiver les coûts et les bénéfices de l’introduction d’une consigne en Wallonie et en Belgique.
Comme le suggère à juste titre Mme Tellier dans son interview, l’étude devrait “évaluer les impacts économiques, environnementaux et autres de l’introduction d’une consigne“. Dans cette analyse coûts-bénéfices, comme cela a déjà été fait dans d’autres études, il est en effet essentiel de fournir une image complète des impacts d’un tel système. Cela potentiellement avec différents scénarios pour moduler les coûts et les bénéfices. Outre les coûts et bénéfices économiques, l’étude devrait également examiner et estimer les bénéfices sociaux et environnementaux.
Les déchets sauvages étant le point central de la politique gouvernementale dans les trois régions, l’étude devrait examiner comment une consigne en Wallonie et en Belgique pourrait contribuer à réduire les déchets sauvages. Une réduction significative des déchets sauvages, et l’amélioration de la propreté publique qui en découle, doivent peser lourd dans les décisions. Les arguments de Comeos, Fevia et Fost Plus ne doivent pas faire perdre de vue au gouvernement l’objectif premier, une Wallonie plus propre, qui rend également plus de 74% de la population favorable à la consigne, selon plusieurs enquêtes (Test-Achats, GfK).
Afin d’avoir une image claire de tout le potentiel d’un système de consigne en Belgique, cette étude devrait également se pencher sur des chiffres plus objectifs et plus précis sur la collecte et le recyclage en Belgique. Plusieurs recherches indépendantes ont calculé des chiffres alternatifs à ceux de Fost Plus pour la collecte et le recyclage (voir RTBF, Recover et notre propre article) et une nouvelle mesure de calcul européenne pour le recyclage est en place. Des chiffres exacts sont nécessaires pour déterminer le gain financier et environnemental réel à réaliser avec la consigne. Chaque point de pourcentage de collecte supplémentaire entraîne d’énormes gains environnementaux (Eunomia, 2022, Figure 4-2, p27).
En Belgique, la gestion des déchets est une compétence des régions. Il est intéressant et important que l’étude de faisabilité implique d’autres régions en les “associant au comité de suivi de l’analyse“, comme annoncé par Mme Tellier.
Les discussions interrégionales sont en effet essentielles pour garantir que le système, s’il n’est pas mis en œuvre directement dans les trois régions, puisse être rapidement étendu à l’ensemble de la Belgique, afin d’offrir un effet positif maximal. Comme les régions de Flandre et de Bruxelles-Capitale mentionnent également l’introduction d’une consigne dans leur accord de coalition, l’avancée de la Wallonie dans la bonne direction est susceptible d’avoir un effet domino rapide sur les deux autres régions. L’introduction d’une consigne en Belgique semble donc désormais inévitable.
Enfin, Mme Tellier évoque l’idée d’un “Mr ou Mme Consigne”, chargé de “consulter et négocier” avec l’industrie. Bien que ce point puisse être intéressant pour assurer la contribution des producteurs responsables de l’emballage (suivant la Responsabilité Élargie du Producteur, REP), cela pourrait aboutir à une discussion fermée “à huit clos”. Comme le prescrit la nouvelle Directive-cadre sur les déchets (article 8, paragraphe b, alinéa 6), les États membres de l’Union européenne doivent assurer “le dialogue entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs”, telles que la “société civile“. Il s’agit là d’un élément clé pour garantir que le système de responsabilité élargie des producteurs sera mis en place de manière à être le plus efficace et le plus largement soutenu. Un comité de réflexion, impliqué de bout en bout pour suivre l’avancement de l’étude (de l’établissement du cadre au suivi des résultats) assurerait une meilleure représentativité de tous les acteurs concernés : municipalités, organisations d’agriculteurs, organisations environnementales et organisations de consommateurs.
Globalement, le lancement de cette étude de faisabilité est un pas dans la bonne direction pour passer du mythe à la réalité et se rapprocher de la mise en place d’un système de consigne en Wallonie, et dans l’ensemble de la Belgique. Cependant, pour respecter l’accord de coalition et mettre en œuvre la consigne sur les canettes et les petites bouteilles en plastique dans le cadre du mandat, l’étude doit être réalisée en temps utile, de préférence dans les six mois, et avec le bon objet d’étude. C’est essentiel pour ne pas retarder davantage l’introduction d’un système de consigne en Belgique. Les demandes des citoyens, des agriculteurs, des environnementalistes et des bourgmestres doivent recevoir une réponse rapide de la part du gouvernement wallon.
Au second semestre 2021, Rijkswaterstaat a compté 41 % de petites bouteilles en plastique en moins parmi les déchets sauvages comparé au second semestre 2020. C’est ce que montrent les résultats des mesures effectuées par le Rijkswaterstaat, rendus publics aujourd’hui par la secrétaire d’État Vivianne Heijnen (see graphique 1).
Des recherches menées par le Zwerfinator Dirk Groot ont montré précédemment que la proportion de petites bouteilles en plastique parmi les déchets sauvages a diminué depuis l’introduction d’une consigne le 1er juillet 2021. Au dernier trimestre de 2021, il a enregistré 70,2 % de bouteilles en plastique en moins par kilomètre que la moyenne des derniers trimestres des années 2017, 2018, 2019 et 2020 (voir graphique 2 pour les mesures de Rijkswaterstaat et Dirk Groot).
Dans la lettre adressée à la Chambre basse, la secrétaire d’État Heijnen se montre positive quant à la baisse de 41 %, mais un système de consigne a le potentiel de réduire de 70 à 90 % le nombre de bouteilles dans l’environnement. C’est ce qu’a conclu CE Delft dans son étude sur la consigne commandée par le gouvernement néerlandais. Ces chiffres ont également servi de base à l’exigence de performance imposée à l’industrie par la secrétaire d’État de l’époque, Stientje van Veldhoven : l’industrie devait réduire d’au moins 70 % le nombre de bouteilles en plastique dans les déchets sauvages d’ici 2020. Devant l’échec de cette mesure, le gouvernement a décidé d’introduire une consigne.
Maintenant que les résultats du monitoring du Rijkswaterstaat sont connus, il apparaît que cette réduction de 70% du nombre de bouteilles en plastique dans les détritus n’est pas actuellement atteinte par le système de consigne néerlandais. Il est important de comprendre qu’il s’agit d’un résultat qui peut être amélioré ; avec un système de consigne bien conçu, la proportion de bouteilles en plastique qui finissent dans l’environnement peut même être réduite de 90%. Telle est l’ambition que nous attendons – et exigeons – du gouvernement néerlandais.
Outre le souhait d’une forte diminution du nombre de bouteilles parmi les déchets sauvages, il y a aussi une obligation légale de collecter séparément 90% des bouteilles en plastique d’ici 2022. Le pourcentage de collecte des petites bouteilles en plastique est donc un autre indicateur qui permet de déterminer le bon fonctionnement du système de consigne.
Lors du débat de deux minutes du 3 février 2022, la députée Eva van Esch, du Parti pour les animaux, a demandé au secrétaire d’État Heijnen les pourcentages de collecte des petites bouteilles en plastique. La secrétaire d’État a indiqué qu’elle attendait un rapport à ce sujet de la part des entreprises le 1er août 2022 et qu’elle serait en mesure d’informer la Chambre basse dès lors. Le 23 février 2022, Statiegeld Nederland a publié un communiqué de presse dans lequel il indique que “depuis le début du nouveau système de consigne à la mi-2021 […], une moyenne de 70 % des bouteilles en plastique ont été retournées”.
Cela montre que le système de consigne ne permet pas actuellement d’atteindre l’objectif de collecte sélective de 90% et qu’il reste un long chemin à parcourir. Une autre remarque importante sur ce pourcentage est qu’il concerne aussi bien les petites que les grandes bouteilles en plastique. Et cela signifie que le chiffre est tiré vers le haut par le pourcentage de retour des grandes bouteilles en plastique, qui est d’environ 95%. Cela montre que le pourcentage de collecte des petites bouteilles en plastique est toujours nettement inférieur à 70%. Et ce sont précisément ces petites bouteilles qui, jusqu’à présent, finissaient en grand nombre dans l’environnement et l’élargissement du système de consigne a été élaboré pour cette raison.
Il faut plus de données et plus de temps pour confirmer une tendance claire et voir comment elle évolue, mais les chiffres fournissent déjà une raison suffisante pour ajuster le système de consigne actuel.
Dans une évaluation intermédiaire, nous avions déjà identifié un certain nombre de lacunes dans la mise en place actuelle du système de consigne pour les petites bouteilles. Celle-ci peut maintenant servir de guide aux politiciens quant à la manière d’améliorer le système.
Il faut remettre l’obligation de reprise pour les points de vente. Dans presque tous les pays qui ont la consigne, une obligation de reprise fait partie de la législation et, aux Pays-Bas, elle faisait partie du décret de 2014 sur la gestion des emballages. En supprimant l’obligation de reprise de la loi, nous sommes maintenant confrontés à de grands magasins tels que AH To Go, HEMA, Kruidvat et Action, à des restaurants tels que McDonald’s et La Place et à des théâtres, cinémas et universités qui ne rendent pas la consigne lorsque le consommateur veut y rapporter sa bouteille. Il doit donc être obligatoire pour les points de vente de rendre la consigne, avec une exception possible pour les petits commerçants.
Une autre lacune est que toutes les bouteilles en plastique ne sont pas soumises à une consigne, mais les boissons contenant des produits laitiers et les jus de fruits en sont exclus. L’ouverture récente du système de consigne pour les jus est une grande amélioration, mais elle se fait sur une base volontaire, ce qui signifie que de nombreux jus peuvent encore être mis sur le marché sans consigne, d’où un manque de clarté pour le consommateur. Par conséquent, introduisez une consigne obligatoire sur les jus de fruits en les incluant dans la loi sur les consignes.
De plus, le montant de la consigne de 15 centimes d’euro est relativement faible, ce qui incite moins les consommateurs à rapporter leurs bouteilles. Par conséquent, il faut augmenter le montant de la consigne minimum à 25 centimes d’euro.
*Notes relatives au graphique 2
Afin de pouvoir comparer les données de Rijkswaterstaat (nombre de bouteilles en plastique dans les déchets sauvages) et du Zwerfinator (nombre de bouteilles en plastique par kilomètre), nous avons utilisé les résultats des monitoring de 2017 comme base de référence pour les deux groupes de données (base 100).